
On a des difficultés à associer Giancarlo del Monaco et Richard Peduzzi qui viennent d’horizons si différents qu’on a lu avec étonnement qu’ils aient pu collaborer au sein de la même entreprise, mais tout est possible et c’est finalement avec une grande disponibilité que cet appariement a été accueilli. D’ailleurs, la production de Giancarlo del Monaco n’a rien de scandaleux ni médiocre : certes, la conduite d’acteurs n’est pas vraiment au rendez-vous, tant ils nous gratifient de gestes convenus, mais le propos d’ensemble n’est pas absurde, que de faire de ce Ballo in maschera en version suédoise une tragédie sombre, à la limite du fantastique.
On le sait Un ballo in maschera est fort difficile à réussir tant vocalement que scéniquement. C’est un opéra à la croisée des chemins entre le Verdi du futur, dramatique, puissant, libéré de la manière belcantiste, et un genre qu’il a effleuré sans toujours y réussir, le Grand Opéra. Ballo in maschera en a les ingrédients, c’est un drame historique retraçant une histoire qui avait marqué son temps, l’assassinat du roi de Suède Gustave III au cours d’un bal masqué, il ya des chœurs importants, une touche d’irrationnel avec Ulrica, et il y a même un travesti, qu’on trouve souvent dans le Grand Opéra et ses épigones (Jimmy de Guillaume Tell, Urbain des Huguenots, Ascagne de Benvenuto Cellini, voire Siebel dans le Faust de Gounod. Le génie de Verdi qui respire dans l’œuvre fait qu’on ne l’a pas classé dans ce type d’œuvre, mais il reste qu’on en trouve des traces nombreuses.
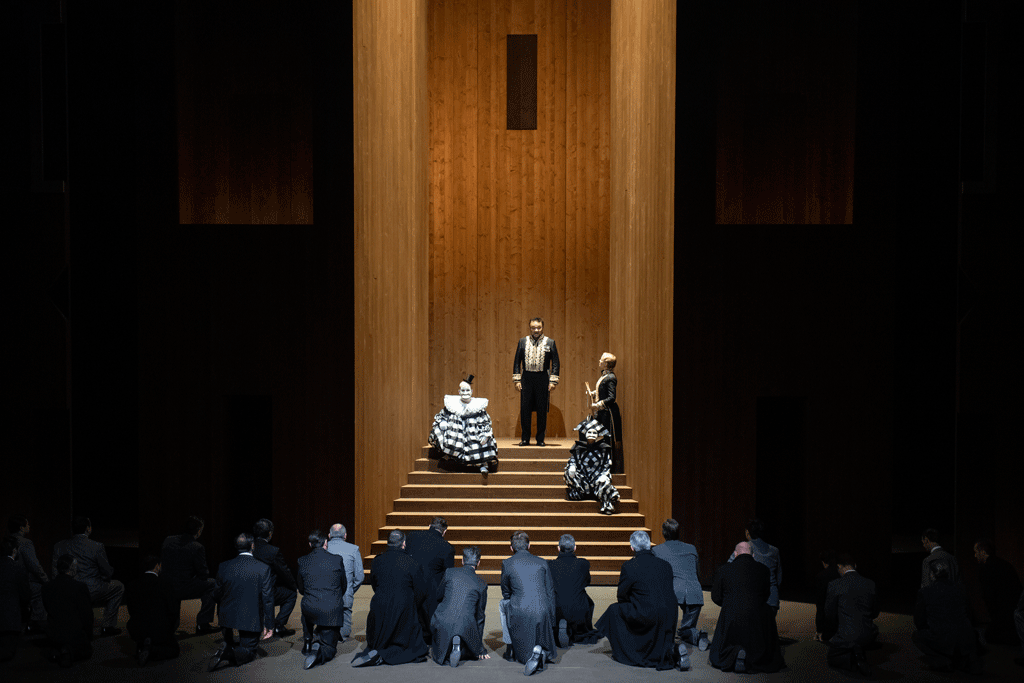
Les décors monumentaux de Richard Peduzzi, par leur côté géométrique et sévère, donnent à l’ensemble un cadre hiératique qui évite les distractions de l’œil vers un décoratif inutile, et cette monumentalité qui écrase les personnages assez réduits sur le plateau, est assez bienvenue : on a là le décor pour l’entreprise assez dépouillée au total de Gianfranco del Monaco, un dépouillement auquel il ne nous a pas toujours habitués. C’est un monde sinistre, compassé, noir, d’où tranche le roi Gustave assez joyeux et plutôt optimiste. Au fur et à mesure que l’œuvre avance, et dès le premier acte avec une pantomime prémonitoire, et avec l’apparition d’Ulrica, on est plongé dans un univers sinon effrayant du moins inquiétant, où conspirateurs, puis maschere du bal semblent des fantômes ou des ombres infernales (costumes de Gian Maurizio Fercioni). Cela donne une ambiance lourde, avec de très bons éclairages de Caroline Champetier, qui a le mérite de ne pas être laide, non dénuée même d’une certaine élégance, et qui ne trouble pas l’audition. C’est une production dans la lignée de ce que nous a proposé Genève ces dernières années qui ne mérite ni cet excès d’honneur ni cette indignité. Une production de grande série, passable, sans éléments qui fascinent ou qui désespèrent, mais qu'on oubliera vite sans doute.

Musicalement, nous avons droit à une production très digne, où la distribution laissera un souvenir plutôt positif. Même si Ramón Vargas n’est plus ce qu’il fut, il reste que le timbre est lumineux, avec une belle technique et une émission juste. Vargas pèche un peu par l’inexpressivité et l’absence totale de couleur dans un chant qui reste monotone. Et comme le chanteur n’est pas vraiment un acteur, les choses ne convainquent pas dans un rôle qui devrait être porté et incarné. Il ne l’est pas, mais la prestation est très honorable, même si en-dessous de la gloire de l’artiste.
Une fois encore Franco Vassallo (qui nous avait bluffés dans la version concertante de Il Pirata), est ici particulièrement convaincant, Sans avoir un timbre si séduisant, Vassallo a le style, la couleur, le contrôle et incarne le rôle : c’est le seul italien de la distribution et cela s’entend par le phrasé, mais aussi l’engagement et la qualité de l’expression. Il triomphe et c’est pleinement justice.

Du côté féminin, L’Oscar pétillant et alerte de Kerstin Avemo, une belle voix de soprano qui éclaire le premier acte et qui surtout, sait remplir la scène, avec une présence notable, d’ailleurs obligatoire pour le rôle.
Judit Kutasi a très bien réussi son Ulrica, voix sombre, profonde, expressivité, couleurs cuivrées composent un personnage complet, même si le rôle est court, il reste important.

Et Irina Churilova, l’Amelia du Simon Boccanegra de Gergiev au Marinskij, est un beau soprano, à la voix puissante, en place, très bien projetée et au total assez expressive, malgré un jeu fruste et académique ; musicalement, c’est un soprano qu’on va je pense revoir sur les scènes d’Europe.
Quant à Pinchas Steinberg, en vieux routier de l’opéra italien, il dirige l’ensemble avec professionnalisme et sûreté, obtenant une belle cohésion d’un Orchestre de la Suisse Romande en forme. Steinberg n’est pas un inventeur, mais est une valeur sûre pour ce répertoire. Mais c’est un des problèmes de l’ère Richter de n’avoir pas su chercher et proposer de jeunes chefs valeureux, qui écument actuellement la péninsule italienne.
Une production respectable, à mille lieux d’un feu d’artifice mais solide qui clôt dignement une période qui n’aura pas été parmi les plus brillantes le Grand Théâtre de Genève.

