
Un spectacle d'une nature spéciale
À spectacle spécial conditions spéciales : Teodor Currentzis promène dans le monde ses musiciens de l’opéra de Perm et son chœur et construit avec eux un travail dont la singularité n'est pas discutable, et qui tisse une vrai rapport artistique mais aussi une histoire. À une époque où les chefs voyagent et passent d’un orchestre à l’autre, cette manière de travailler semble venue d’un autre âge, mais semble en même temps lui réussir, tant sa personnalité fascine et ses approches musicales étonnent, même si elles se discutent .
La deuxième remarque concerne les conditions d’Amsterdam, un opéra sans orchestre fixe qui peut ainsi sans problème accueillir MusicAeterna dans ses murs, et un opéra typique du système de stagione, où tout est concentré sur la production du moment sans l’installer dans la durée parce qu’il n’y aura pas de reprise sinon lointaine. De plus, Amsterdam est réputé pour le soin et l’originalité apportées aux productions (Effet du travail de management artistique de Pierre Audi qui termine l’an prochain son mandat). On verra comment le troisième coproducteur, la Deutsche Oper Berlin, opéra de répertoire, accueillera la production.
Troisième remarque : la production de Peter Sellars et l’entreprise de Teodor Currentzis se justifient pleinement dans le cadre d’un Festival (Salzbourg) ou (théoriquement) on essaie des parcours différents. C’est pourquoi il faut prendre cette production pour ce qu’elle est, une lecture singulière, affirmée et idéologique de La Clemenza di Tito, une œuvre qui célèbre le « souverain éclairé » par les Lumières, et qui ici s’affirme comme une œuvre emblématique des difficultés et des contradictions du monde dans ses rapports au pouvoir. L’américain Peter Sellars, imposant une distribution symbole de la « diversité » comme on dit aujourd’hui dans la novlangue médiatique, et surtout un Titus noir, ne peut pas ne pas avoir pensé à Barack Obama, et à la destruction systématique de son œuvre par son successeur. Sellars impose une vision où face à un Titus, un Publio, un Annio noirs, une Bérénice voilée, une Servilia métis, ce sont les blancs (Vitellia, Sesto) qui complotent et créent le désordre (c’est du moins la vision qui ressort à Amsterdam, parce que la Vitellia de Salzbourg, Golda Schultz, une chanteuse de couleur, tendrait à moduler cette lecture). Cette vision des enjeux des temps futurs, où la diversité est vécue comme un danger jusqu'à l'assassinat traverse toute la lecture – et avec quelle force ! – de Peter Sellars, qui semble s’être souvenu qu’il avait du génie, après des productions relativement médiocres vues çà et là où l’on a semblé plus s’extasier sur le souvenir de son nom que sur ce qui nous était donné de voir.
Une dramaturgie spécifique

Dès l’ouverture, les rapports de pouvoir sont installés, et la dramaturgie mozartienne, où l’apparition de Titus est retardée, est battue en brèche par l’apparition immédiate de Titus saluant la foule surveillée par des soldats ; sa présence est en effet permanente, derrière les structures abstraites qui font décor (de Georges Tsypin, qui semble inspiré par les "Pillars" de l'artiste libanais Marwan Rechmaoui ((Exposé dans les collections permanentes de la Tate Modern)) ), dans l’ombre, avec une Bérénice voilée, qu’on ne voit pas habituellement, dont le voile nous indique qu’elle n’est pas souhaitée comme épouse parce qu’elle est musulmane. Tout cela installe dès le départ l’opéra de Mozart d‘emblée dans des problématiques typiques de la complexité du monde d’aujourd’hui.
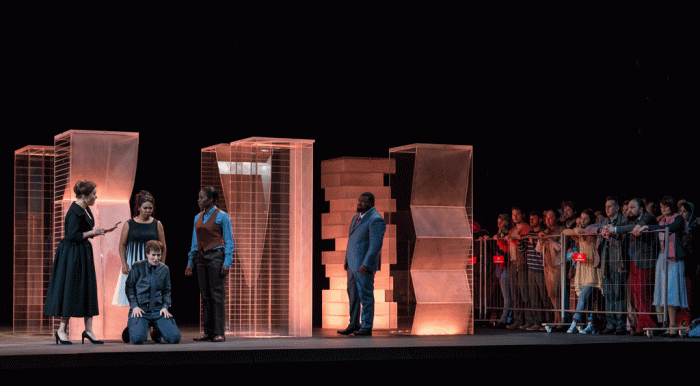
Du même coup, Sellars va moins s’intéresser aux rapports entre les personnages, les amours de Sesto et Vitellia par exemple, qu’à ce qu’ils représentent dans le jeu des rapports de pouvoir.
Ainsi comprend-on parfaitement l’insertion d’autres œuvres de Mozart dans le spectacle. Elles ne s’ajoutent pas inutilement parce qu’elles éclairent la thématique de la production. Comment expliquer par exemple la joie finale de l’opéra de Mozart si Sellars fait mourir Titus ; ajouter la Musique funèbre maçonnique en ut mineur autour du cadavre de Titus prend alors tout son sens. Les autres insertions sont elles aussi bienvenues, et suivent le fil cohérent de la trame et des situations : que ce soit la « Benedictus » de la Messe en ut mineur, pour saluer l’Empereur, ou son « Kyrie » pour déplorer sa tentative d’assassinat, ou l’Adagio et Fugue en ut mineur pour accompagner les « terroristes » (ainsi le surtitrage traduit-il « traditore »), ces insertions ne sont pas superfétatoires mais renforcent au contraire la valence dramatique et politique de la production et ce qu'elle affirme. Et à ceux qui ont reproché l’opéra d’être ainsi trop long, on peut répondre en pirouette qu’on n’a jamais trop de Mozart. Dans un autre contexte, évidemment ces ajouts pourraient se discuter, ils sont ici parfaitement à leur place et ne choquent aucunement.
Ainsi, dans cette vision, Sesto rejoint une cellule terroriste, on lui met une ceinture d’explosifs et il part dans la foule, pendant l’incendie du Capitole. Chez Mozart, on croit Titus mort, chez Sellars, Sesto réussit son coup et blesse Titus si gravement qu’il semble laissé pour mort au final du premier acte..

Un second acte vu comme longue déploration
Ainsi donc le second acte devient une longue déploration, une cérémonie où le chœur mêlé au public qui retourne dans la salle après l’entracte muni de veilleuses va les déposer au fond de scène : leur présence permanente marquera l’ambiance recueillie et désespérée qui va marquer cette deuxième partie. D’un côté un Titus sur son lit d’hôpital qui survit avec le cas Sesto sur la conscience tout en s’interrogeant sur le sens de son pouvoir, de l’autre le reste des personnages qui essaient d’atténuer l’inévitable sentence qui va frapper Sesto. Dans le contexte de violence politique installé, la renonciation au pouvoir de Vitellia ne prendra que plus de relief. Si La Clemenza di Tito est un combat dialectique , raison d’Etat contre raison du cœur, cette production propose ce combat au bord de la mort des deux protagonistes, Sesto condamné et Titus blessé à mort.
Dans ce contexte aussi, le personnage de Titus, remarquablement interprété par Russell Thomas, prend un tout autre relief : il est mourant et doit laisser un message à la postérité, ou bien un message de pouvoir, ou un message d’humanisme, un humanisme qui sera alors dicté non par un calcul politique (la clémence est toujours une arme politique quand c’est le souverain qui en use), mais par le désespoir d’un individu qui va se laisser mourir devant l'aporie de son pouvoir. Au bord du trépas, il laisse les autres en vie puisqu’il n’en tirera pour lui aucun avantage, il meurt plus en homme qu’en souverain.
Dans cette Clemenza di Tito, on l’aura compris, Titus c’est une figure et non un personnage historique, c’est la figure du souverain, l’incarnation du pouvoir et de son échec. Cette vision pessimiste nous montre aussi que dans nos sociétés modernes, l’idée d’un pouvoir tolérant et idéal ne fonctionne pas face à la question du « terrorisme » qui ne fait pas la différence. Et c’est bien là la question centrale qui va irriguer toute la deuxième partie.

Un choeur personnage
Un des éléments clés de cette mise en scène est la présence quasi permanente du chœur, vu comme un exemple de la diversité du peuple, et néanmoins de sa cohésion autour du souverain, divers et toutefois UN. Au peuple Sellars confie les œuvres insérées, comme des commentaires d’un chœur antique, affirmant ainsi sa présence mais là aussi le terrorisme ne traduit que les dérives d’un comportement individuel n’a que faire du sentiment populaire ou de la nature du gouvernement. La présence populaire, est affirmée enfin dès l’ouverture parce que c’est le premier personnage en scène.
L’œuvre de Metastase et de Mozart faisait du drame une somme d’enjeux individuels de personnages qui fonctionnaient en circuit fermé, le peuple n’étant que décoratif dans deux ou trois scènes. Ici il est au centre, il est chœur antique, mais aussi personnage omniprésent, et en même temps seulement spectateur de l’éternel drame du pouvoir, comme si y compris dans nos sociétés, le pouvoir lui était systématiquement confisqué (lire à ce propos les remarquables analyses d’Alain Deneault ((La médiocratie, Lux Editeur, Québec, 2016 et Faire l’économie de la haine, Éditions Écosociété, Québec, 2018)) sur les dérives de notre société et la confiscation « soft » du pouvoir. Un peuple omniprésent mais encore et toujours décoratif face aux conflits des protagonistes.

Titus image du "black power"
Ainsi cette mise en scène est-elle à la fois une parabole du pouvoir aujourd’hui et ce qu’il suppose être : en affichant un pouvoir noir, un « black power », il créé une plaie irrémédiable : ce « black power » qui est le modèle du bon gouvernement est battu en brèche par ceux qui le refusent, des blancs, des aristocrates, pour son identité même, pour ce qu’il est et non pour ce qu’il fait, parce qu’ils sont blancs. Bien sûr il y a toute une chaîne de causalités qui mène à ce constat, qui ne passe pas explicitement par une question de couleur de peau : mais Sellars est ici très clair visuellement : les « blancs » sont ici les traîtres, qui trahissent même leur amitié, le plus doux des sentiments (Sesto) et qui chosifient l’autre pour parvenir à leurs fins.
Tout bascule bien sûr pendant le second acte où tous ont leurs yeux dessillés devant le drame qui est survenu, et où l’on bascule vers quelque chose d’éminemment individuel, les sentiments de Titus, ceux de Sesto, ceux de Vitellia s’exposent et constatent le gâchis universel, et irrémédiable car il est clair que Titus va mourir. L’agonie de Titus est mise en scène dans une sorte de mort programmée, longue, presque une mort baroque (la manière dont il se tort a quelque chose à voir avec la sculpture baroque) et comme jadis Peter Sellars l’avait fait pour Don Giovanni, il y a très longtemps, les agilités ou les vocalises de ses airs se traduisent en signes corporels de douleur (On se souvient dans Don Giovanni Donna Anna se piquant et traduisant son état par les vocalises de son air « Non mir dir »…). C’est un Titus affaibli dont on a l’impression que les autres profitent de la faiblesse, comme si chacun pensait déjà à « l’après Titus »…
Comme on le voit, Peter Sellars cultive une sorte de double langage où le livret est l’objet d’une lecture au premier degré, bons sentiments, tristesse et déploration, mais qui pourrait aussi être lue au second degré, où les bons sentiments recouvrent des calculs de pouvoir moins propres. Et c’est bien le sens de ce travail que de montrer les possibles de cette histoire de pouvoir, où la mort du Prince risque de rebattre les cartes, au-delà des sentiments privés. Ce qui est clair, c’est que la cérémonie funèbre qu’est ce deuxième acte, une longue déploration, presque une Passion, ne peut être lue, à cause même des choix affichés de Sellars, comme une sorte de « pezzo chiuso », un en soi. La mort de Titus, de ce Titus-là plus abstraitement « le souverain » est l’occasion de rebattre des cartes de ce monde construit par et pour lui, qui se retrouve sans lui.
Une musique singulière, au service du projet dramaturgique
Pour une option aussi puissante, il fallait évidemment que le spectacle soit une Gesamtkunstwerk qu’on n’imagine pas sans ce chœur-là ni cet orchestre-là.
Le choeur : Le chœur de musicAeterna apparaît désormais pleinement à sa place et dans son rôle de protagoniste incontesté, et de personnage divers, fait de toutes les classes et toutes les religions, un peu d’ailleurs une sorte de mosaïque d’une société moderne, avec des costumes dont la couleur pourrait aussi être russe, la Russie étant aussi (encore) une mosaïque de peuples divers. Musicalement, il est puissant, mais aussi très subtil (les extraits de la Messe en ut mineur par exemple qui lui offrent à la fois la joie et le triomphe, mais aussi la peine et la déploration, l’extériorité et l’intériorité). Et c’est évidemment un effet de la mise en scène qui le rend si impliqué : c’est parce qu’il est complètement engagé dans le jeu qu’il arrive à s’exprimer avec cette variété de couleurs et d’émotions qui trahissent aussi une préparation sans doute millimétrée de leur chef Vitaly Polonsky. Et le résultat est exceptionnel de vibration et de justesse.
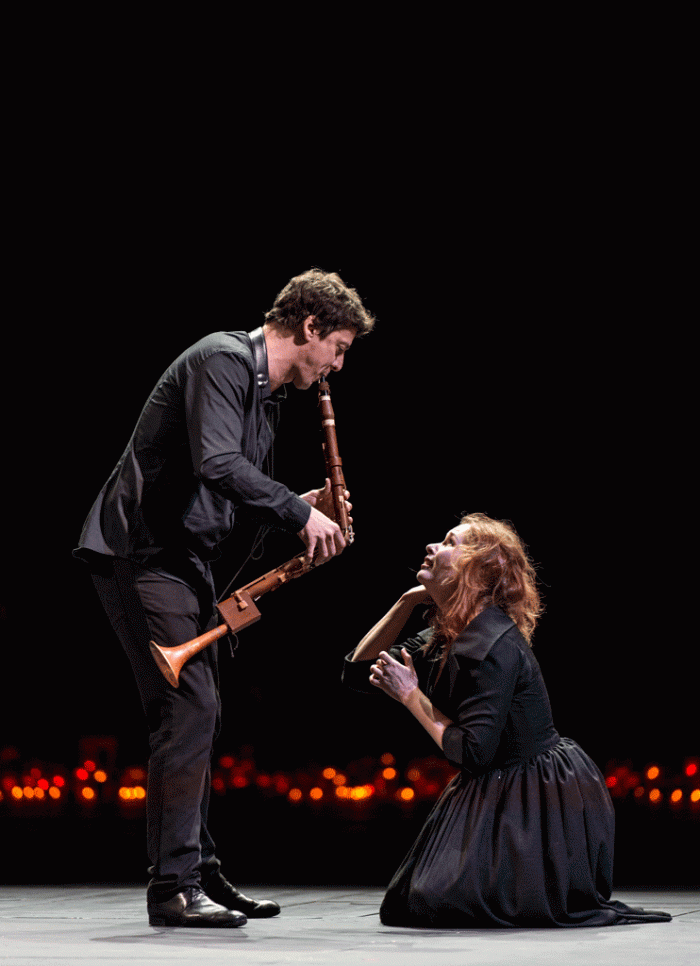
L’orchestre :
MusicAeterna atteint aussi des sommets de raffinements, de justesse de ton, avec des morceaux de bravoure (la clarinette, le cor de basset de Florian Schüle qui participent sur scène à la mise en scène en un dialogue voix-instrument à l’effet bouleversant (cependant déjà vu ailleurs…). Il est quelquefois (l’ouverture), emmené à un rythme d’enfer, difficilement concevable, à d’autres, il se fait sourdine, mais reste toujours d’une limpidité exemplaire, avec des balances de volume surprenantes mais toujours en phase avec le plateau : on comprend en entendant ce travail qu’au disque Currentzis puisse quelquefois faire discuter (on l’a vu à propos de son récent Don Giovanni).
Une musique bousculée et qui bouscule
Les coups d’archet brutaux, les variations subites de volume, les accélérations bouleversent complètement notre écoute d’une œuvre quelquefois accusée d’être un peu ennuyeuse, de même les contrastes d'une extrême vélocité avec les moments très ralentis : dans le contexte scénique, la manière d’engager l’orchestre (comme le chœur) permet une écoute tendue, toujours en éveil, jamais apaisée, même si les silences sont souvent longs, très longs (« parto… ») et volontairement pesants. D’un autre côté, les accélérations sont si fortes qu’elles forcent quelquefois le chanteur à savonner les vocalises, et le mettent en difficulté (c’est patent dans les dernières scènes du 1er acte), mais l’ensemble garde une forte cohérence et une très forte prégnance théâtrale. Enfin, la quasi suppression de tous les récitatifs crée aussi des effets de heurts entre les airs ou les ensembles, avec quelquefois des conséquences sur les voix très sollicitées sans que le récitatif aide à poser psychologiquement la situation. Cela contribue à la singularité du projet, discutable et discutée. Bien sûr on peut être aussi agacé par la gestuelle de Currentzis, sa manière d’occuper l’espace (voir ci-dessous notre compte rendu de sa Clemenza genevoise), mais dans la fosse, il reste tout de même dans l’ombre (!) avec une attention au plateau de tous les instants. Il est faux d’accuser cette direction d’histrionisme comme on a pu le lire : elle est profondément musicale, et parfaitement théâtrale aussi, et il faut la lire à l’aune du travail d’ensemble, c’est un spectacle total où chacun assume pleinement son rôle et où chacun se répond.
Cette cohérence des masses musicales, leur implication dans le travail scénique devrait laisser penser que la même distribution, comme le reste devrait accompagner la production là où elle est présentée. Or, Salzbourg, Genève (et TCE à Paris) et Amsterdam présentent de nettes variations.
Une distribution homogène
Comme à Salzbourg, on retrouve Russell Thomas, un Titus impératif dans ce contexte, Jeanine De Bique en Annio, et Sir Willard White en Publio. Tous les autres chanteurs sont différents, à commencer par la jeune Servilia de Janai Brugger, Ekaterina Scherbachenko en Vitellia et Paula Murrihy en Sesto, ce qui évidemment modifie sensiblement les choses, y compris dans la lecture de la mise en scène .
Disons d’emblée que ces changements, qui peuvent affecter la lisibilité d’un rôle ou sa couleur (entre Scherbachenko à Amsterdam et Golda Schulz à Salzbourg il y a quelque différence…), n’affectent en rien la cohérence et l’homogénéité de l’ensemble, et c’est aussi un signe de la plasticité du travail de Sellars.
La distribution de La Clemenza di Tito est divisée en deux groupes égaux, les protagonistes, Titus, Sesto, Vitellia et les trois rôles de complément, Publio, Annio, Servilia qui assistent au drame ou qui en sont momentanément l’objet (lorsque Titus veut choisir Servilia comme impératrice), l’un des qualités du travail de Sellars est d’atténuer ces différences dramaturgiques : les personnages presque toujours en scène apparaissent comme un ensemble, sans vraie différence d’importance, et il en résulte une sorte de drame à six.
Publio est Sir Willard White, le rôle semble fait pour lui : sa personnalité, sa voix, son allure dans son costume de général américain, l’imposent beaucoup plus que dans n’importe quelle autre mise en scène où Publio est un rôle vraiment secondaire. La voix profonde fait encore autorité, avec son timbre légèrement voilé, mais aussi avec sa couleur qui lui donne une véritable humanité. Une composition qui marquera sans nul doute le rôle.

Servilia est la jeune américaine Janai Brugger, qui remporta le concours Placido Domingo Operalia en 2012. La voix claire, affirmée, riche de couleurs, émouvante, correspond parfaitement au rôle, on sent derrière les rôles de soprano lyrique qui l’attendent, de Micaela à Mimi. La technique impeccable montre aussi qu’elle se glisse parfaitement dans le rôle et dans la production avec un beau « Laudamus te » de la messe en ut. Servilia est un rôle non « important » dans l’œuvre de Mozart, mais hautement emblématique puisqu’elle ose refuser l’offre impériale de Titus, par amour pour Annio : elle représente la vérité du cœur face aux vérités du pouvoir. Elle est une anti-Vitellia, qui affirme une des valeurs clefs de l’ère des Lumières, l’union de l’être et de l’apparence et l’incapacité à masquer ses sentiments : son interprétation incarne cette simplicité qui est celle de la vérité : une belle découverte.
Nous avions noté déjà à Genève la personnalité et la voix délicieuse de Jeanine De Bique, un Annio (soprano et non mezzo comme on le distribue d’habitude) originaire de Trinidad et Tobago. Tout comme Janai Brugger, Jeanine De Nique sait afficher une fraicheur simple dans le personnage, avec une vraie voix, sensible et affirmée, qui sait dominer les agilités redoutables de « Tu fosti tradito » et à qui la mise en scène donne un rôle vocal non indifférent en lui donnant à chanter en plus le « Kyrie » de la Messe en ut, où elle fait vraiment preuve d’un chant sensible, émouvant et dominé techniquement, qui garde toutefois une fragilité qui lui donne une véritable humanité.
Vitellia est Ekaterina Scherbachenko et c’est peut-être la déception de la distribution. La voix n’est pas homogène, notamment dans les graves, les agilités mal dominées : certes le timbre métallique correspond bien au personnage, mais dans tout le premier acte le rôle semble mal dominé, avec des problèmes de justesse récurrents et surprenants. En revanche, son deuxième acte est bien plus en place et son « Non più di fiori » est émouvant, techniquement très en place qui remporte un beau succès mérité. Il reste que ce rôle – très difficile à distribuer – ne lui convient pas vraiment notamment à cause de ses interventions au premier acte.
Le Sesto de Paula Murrihy est très émouvant et très juste, même si la voix et la personnalité ne s’imposent pas avec l’autorité de grands Sesto comme aujourd’hui Stéphanie d’Oustrac, magnifique à Genève ou Marianne Crebassa, déchirante à Salzbourg voire comme jadis Ann Murray ou Tatiana Troyanos. Mais c’est un Sesto délicat, plus adolescent qu’adulte, bien dominé techniquement aussi bien dans les agilités que dans la maîtrise du volume, un Sesto presque immature, même si dans cette production Vitellia n’est pas non plus la dominatrice qu’on peut voir ailleurs. C’est bien justement cette image d’un Sesto un peu perdu qui est touchante. Le Sesto de Paula Murrihy n’est certes pas spectaculaire, mais très présent, émouvant et tendre, plus instrument que maître de son destin.
Russell Thomas est un grand Titus, la voix est plus puissante que l’habitude, encore que Titus, comme Belmonte, soit un de ces rôles qui annoncent de futurs Lohengrin (Gösta Winbergh, Ben Heppner), mais sans rien d' habituel, ni de conformiste. Car ce chant quelquefois rauque, quelquefois plus fortement dramatique qu’orné, lui donne une présence singulière, notamment en deuxième partie, dans cette agonie baroque dont il était question plus haut : sa manière d’inscrire les vocalises dans un jeu, dans une causalité et de n’en point faire de simples éléments d’ornementation est emblématique à ce titre. La vocalité devient ainsi presque fonctionnelle, fortement, voire violemment déterminée par la manière dont le rôle est vu par la mise en scène. Russell Thomas l’investit complètement, colorant son chant, n’hésitant pas à aller contre tout ce qu’il peut avoir de décoratif pour en faire un rôle de caractère. Incarnation étonnante et convaincante, dans ce contexte.
Contexte : voilà le maître mot de cette production qui, au lieu de souligner une vision mozartienne du despote éclairé, du souverain dispensateur de biens et en l’occurrence « délices du genre humain » comme Titus était qualifié, souligne les contradictions par nature des situations de pouvoir dans le monde d’aujourd’hui, et ce que suppose la notion de clémence ou même de bon gouvernement…la vision initiale d’un peuple derrière des barrières, sur lequel sont pointées les armes des gardes et la manière dont Titus va vers lui déjà sont des indices de l’irrémédiable solitude du souverain. Sellars regarde le peuple, le souverain, et la cour, avec ses courtisans et ses comploteurs sans complaisance, dans un monde où les relations se tendent plus que jamais : à ce titre, Titus qui sur son lit de mort pardonne à tous laisse après lui un champ de ruines. Dans le nouveau monde comme dans l’ancien, il n’existe pas de bon gouvernement…


Avec un décortiquage très fouillé, comme d'habitude, vous arrivez à tordre la réalité. J'ai vu la vidéo de Salzbourg. Sellars, que j'ai souvent apprécié, se parodie, peu inspiré il plaque des problèmes contemporains sans rapport avec l'oeuvre initiale. Currentzis avec un excellent orchestre tient tellement à marquer sa différence qu'il ne sait plus quels moyens inventer. Le plus surestimé des chefs. Mozart était un excellent dramaturge, pas besoin de rajoutés qui détruisent ses enchaînements et sa conception. Cf l'enchaînement au 1er acte entre le trio (Vitellia, Annio, Publio) et l'entrée de Sesto tourmenté qui va commettre l'attentat, est un moment musical miraculeux.…détruit par ces Messieurs qui préfèrent insérer un "moment Musical" qui anéantit l'effet voulu par Mozart. Ce même été 2018, Glyndebourne donnait un version respectueuse de l'oeuvre. Mise en scène, un bon cru de Claus Guth, avec au coeur d'une bonne distribution le merveilleux Titus de Richard Croft. À visionner pour se laver les oreilles des abus que vous arrivez à justifier.