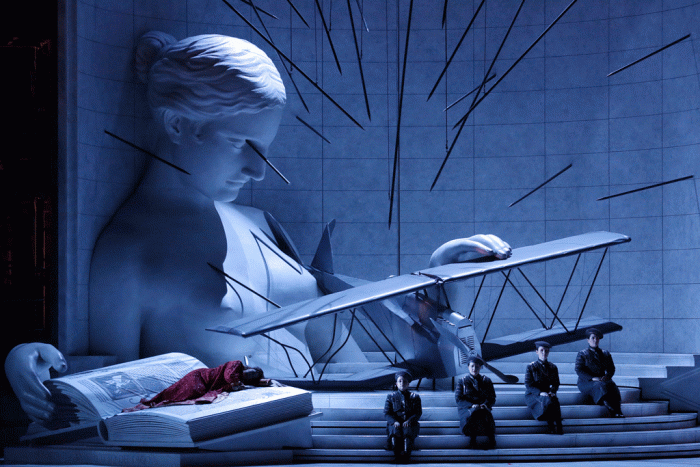Le décor de Leslie Travers pourrait être repris pour Les Troyens, c’est dire la monumentalité du propos pour une œuvre qui frappe plus par sa délicatesse et son lyrisme que par son aspect épique, certes important au final du second acte, mais cela justifie-t-il une telle machinerie ? C’est bien là le problème de cette production au demeurant très respectable, dont on comprend d’ailleurs les intentions. Pountney a plutôt lu « D’Annunzio » que Zandonai et son décor reflète les rêves épiques du dramaturge italien : les canons pointés vers le public semblent prendre Fiume, la statue gigantesque renvoie à une image symbolique écrasante de l’antiquité et le biplan abîmé de la deuxième partie nous renvoie au monde d’Annunzien et à l’héroïsme guerrier. C’est bien la littérature qui est le centre de cette production, où le lit des amants est un livre ouvert dont on tourne les gigantesques pages qu’elles soient dantesques (l’histoire vient de l’Enfer de Dante Alighieri) ou d’Annunziesques. « Qu’on ne me parle de rien qui soit petit », et qui a visité de Vittoriale au bord du lac de Garde, concentré de références à l’antiquité, à la renaissance mais aussi à la guerre avec le croiseur Puglia installé dans le jardin avec son canon pointé, sait ce qu’est le monde mythique de Gabriele d’Annunzio. Disons que Pountney a voulu faire un rêve dantesque de D’Annunzio et en tant que tel, ce n’est pas mal réussi.
C’est dans ce contexte que Francesca, qui croit être promise au beau Paolo, se retrouve mariée de force au frère, Giovanni « lo sciancato » (le boiteux), et finit par tomber amoureuse de son beau-frère (au propre et au figuré) et le paiera non seulement de sa vie, mais de sa mort aussi puisqu’elle se retrouve en Enfer (de Dante).
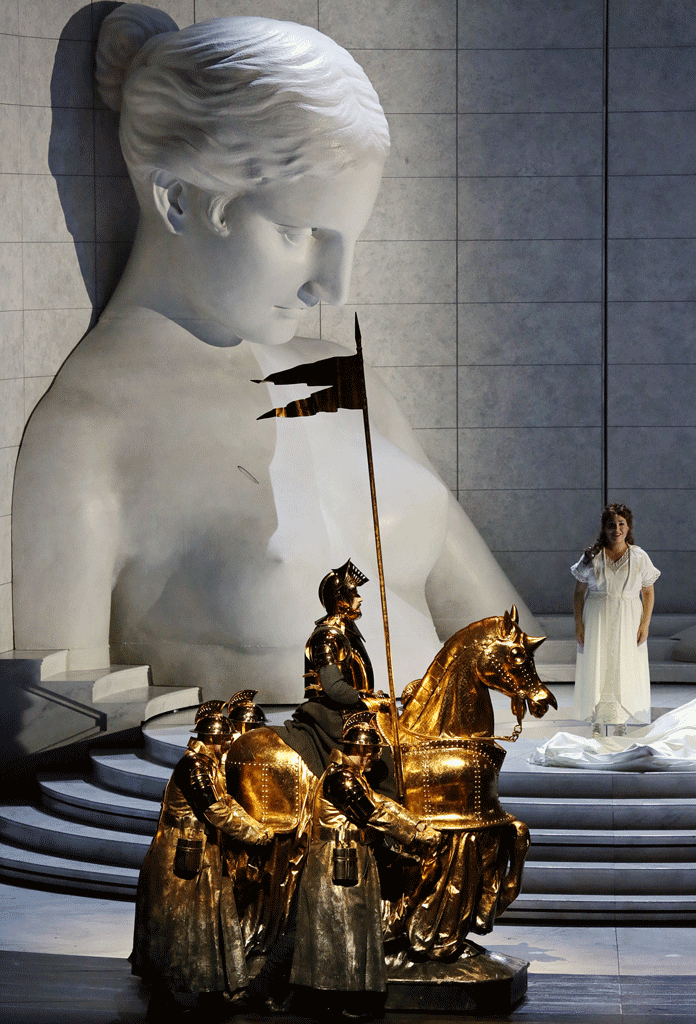
Il y a dans cette mise en scène un peu écrasante de belles idées : l’apparition du chevalier tout doré dont rêve Francesca, le livre qui est livre et lit (une jeu de mot qui fonctionne encore mieux en italien où le lit (letto), est aussi ce qui est lu (letto), qui est le lieu de rêve un peu bovaryste de Francesca qui ne voit la vie qu’à travers les récits fantastiques de chevalerie (Lancelot, Guenièvre…). Il y a dans l’évocation de Pountney une relation nette à l’action par la littérature, à la littérature comme vraie vie. Il y a de moins bonnes idées, comme l’immense statue et le mur gigantesque qui ferme le décor transpercé par des lances de plus en plus nombreuses, symbole assez pâle du drame qui se resserre autour des amants, du cadre mythique installé par Francesca, par Dante, par Zandonai, qui s’abîme au fur et à mesure (renforcé dans la dernière partie par le biplan écrasé, comme si tout ce malheur s’accumulait autour d’amants qui n’en ont cure).
C’est une production qui vaut par son décor, très réussi esthétiquement, mais pas vraiment par la conduite du jeu d’acteurs, plutôt traditionnel, c’est à dire inexistant : gestes attendus et stéréotypés (Francesca- Marie José Siri !), attitudes conformes, le méchant(Giovanni) est très méchant, et le ballet des dames de compagnie savamment organisé dans la géométrie de plateau.
Un écrin respectable pour la musique, une mise en scène d’une grande lisibilité, parce qu’elle est toute dans le visuel, sans gratter plus loin dans la psychologie, car de psychologie il n’en est pas vraiment question : nous sommes dans la typologie habituelle de l’opéra, une jeune fille, un beau, un méchant, un fourbe : la jeune fille épouse le méchant, mais elle se donne au beau et elle est trahie par le fourbe.

C’est dans l’accompagnement musical qu’il faut trouver son vrai bonheur. Le chœur dirigé par Bruno Casoni, qui apparaît seulement dans la première partie est somptueux, héroïque, puissant et sa prestation rappelle que le chœur de la Scala est irremplaçable quand il s’engage, le final de l’acte II, qui est tout l'opéra pour le chœur (Vittoria ! Vittoria !) est particulièrement impressionnant.
Fabio Luisi au pupitre de l’orchestre de la Scala a produit un travail exemplaire, peut-être sa direction la plus convaincante que j’ai pu entendre : il n’abdique jamais l’idée que cette œuvre est d’abord une œuvre sur la couleur, où les pupitres de l’orchestre (les bois !) sont sollicités pour l’évocation lyrique d’ambiances irisées, qui renvoient plus à un monde debussyste qu’à Mascagni, le maître de Zandonai. Il en résulte un orchestre qui jamais ne couvre le plateau, d’une limpidité exemplaire qui montre les détails multiples de cette partition, mais qui sait aussi produire un son plein et charnu, voire être épique (final de l’acte II), la deuxième partie, beaucoup plus intimiste, est une très grande réussite, même dans des moments qui semblent moins passionnants (l’ensemble des dames au début du troisième acte, merveilleusement accompagné) : une direction qui n’impose jamais ses muscles, mais qui au contraire montre une belle subtilité et rend justice à la vraie nature d’une partition qui renvoie au monde pré-raphaélite plus qu’au vérisme avec laquelle on la confond quelquefois.
C’est sans conteste la grande réussite de la soirée que cette direction musicale, car la distribution, honorable dans son ensemble, ne réussit pas à s’imposer chez les protagonistes.
L’ensemble des nombreux rôles secondaires est très en place, notamment la jolie Samaritana d’Alisa Kolosova, et l’ensemble des dames de compagnie (Sara Rossini, Valentina Boi, Diana Haller, Alessia Nadin).

Luciano Ganci, le frère fourbe (Malatestino dall’occhio) est assez expressif, et la voix porte, même si on souhaiterait quelque chose d’un peu plus interprété et plus subtil.
Gabriele Viviani avec sa belle voix de baryton puissante et expressive, bien contrôlée, s’impose dans son personnage de méchant, avec une forte présence en scène : la voix est imposante, et l’interprétation réelle. C’est sans doute le plus convaincant du plateau parce que son chant n'a pas la brutalité tout d'une pièce de certains méchants d'opéra, mais qu'il sait vraiment donner du relief et de la couleur.
Marcelo Puente ( qui a aussi chanté le rôle à Strasbourg l’automne dernier) en Paolo est plus pâle. La voix n’a pas toujours la projection voulue pour la Scala, le timbre assez séduisant n’a pas cependant la séduction solaire souhaitable dans le rôle (Alagna où es-tu ?). La prestation est honorable, mais manque un peu de la personnalité qu’il faudrait imposer ici et aussi d’une certaine profondeur dans l’interprétation plutôt linéaire, même si dans l’héroïsme la voix est plus présente.
Maria José Siri remporte le plus grand succès du plateau, la voix est bien projetée, et suffisamment puissante pour imposer son beau soprano lyrique (spinto par moments dans cette œuvre). Mais il manque ce qui doit caractériser Francesca, l’expressivité, la couleur, l’interprétation : ce chant sans grand reproche technique reste anonyme, et n’arrive jamais à émouvoir, et comme le jeu reste frustre, on reste sur sa faim. Francesca est un de ces rôles très difficiles où ce n’est pas tant la stricte performance qui compte que ce qu’on en fait dans la continuité car le rôle est particulièrement long et demande une grande variété expressive : il manque au premier acte l’innocence et le rêve, il manque la sensualité dans la dernière partie. Les notes sont là, la musique un peu moins…Ma première Francesca fut Raina Kabaïvanska, et son souvenir est loin d’être effacé.