
A l’instar de Turandot, de dix ans antérieure et inachevée, Lulu pose la question de l’inachèvement de l’œuvre et du champ qu’elle ouvre aux solutions alternatives. Mais focaliser sur l’inachèvement suppose à la fois de proposer une solution musicale si l'on ne veut pas revenir à la tradition des deux actes puis de la Lulu Suite, et en même temps la poser du point de vue scénique : malgré la présence du livret, l’inachèvement dans une logique de Gesamtkunstwerk, doit être posé pour le travail sur le personnage et les contextes, car l’œuvre s’ouvre alors sur des possibles multiples.
Christoph Marthaler connaît la musique et son travail au théâtre ou à l’opéra fait de la musique un élément central, voire fondateur. Par ailleurs, c’est d’abord un constructeur d’univers, au risque de rêver sur le livret en le déplçant, d’où le désarroi de certains spectateurs devant ses travaux, que ce soit l’éphémère Nozze di Figaro à Paris, éliminé de manière imbécile par l’équipe qui succéda à Mortier, ou La Grande duchesse de Gerolstein à Bâle, qui commence en Offenbach et finit en Haendel, en une sorte de méditation abstraite sur la guerre qui détruit tout, et ne laisse la musique qu’à l’état de fragments. Héroïne de ce spectacle, Anne Sophie von Otter fut héroïne aussi des Contes d’Hoffmann du même Marthaler à Madrid, moins radicaux mais tout aussi dérangeants.
S’étonnera-t-on alors de retrouver Anna Sophie Von Otter comme Comtesse Geschwitz dans cette Lulu où elle apparaît au départ comme une lointaine cousine de la Muse des Contes d’Hoffmann. Dans les trois cas, Marthaler s’appuie sur les questions d’édition des œuvres, souvent problématiques chez Offenbach, et particulièrement aigus chez Berg (on se souvient de l’opposition farouche d’Hélène Berg à un achèvement de Lulu). Il s’appuie sur l’ouverture offerte par ces questions pour élargir les possibles du contexte et en accord avec le chef Kent Nagano, avec lequel il a fait un magnifique travail, on ne va convoquer dans cette version que la musique de Berg et elle-seule, en osant un troisième acte au piano suivant la particell laissée par Berg, jouant les notes que Berg a laissées et seulement elles ((avec les parties non instrumentées)). Cette volonté de ne jouer que les notes de Berg change évidemment la vision scénique du troisième acte, impossible à représenter comme si on jouait la version Cerha, ce qu’on voit en scène devant être un écho de ce qu’on entend. De plus, Kent Nagano et Christoph Marthaler se sont penchés d'une autre manière sur cette question princeps de l’inachèvement : la composition de Lulu a été interrompue par celle du concerto pour violon « à la mémoire d’un ange » consécutif à la mort prématurée en 1935 de Manon Gropius, fille de Walter Gropius et d’Alma Mahler qui affecta beaucoup le couple Berg. Et ce concerto pour violon est un peu un requiem intimiste à la mémoire de la jeune fille.
La mort empêcha Berg de revenir au troisième acte de Lulu, et du même coup, le concerto « à la mémoire d’un ange » est la dernière œuvre orchestrée par Berg, substitutive en quelque sorte de son troisième acte. Il n'y aurait pas grand intérêt à afficher une volonté exclusivement musicologique de jouer en scène finale les musiques de Berg composée pour Lulu et en marge de Lulu. Mais l’entreprise surprenante à première vue de jouer l’intégralité du concerto en scène finale de l’opéra se justifie par la dernière réplique de Geschwitz qui est aussi la dernière réplique de l’œuvre : « Lulu ! mein Engel ! Laß dich noch einmal sehen ! ich bin dir nah ! Bleibe dir nah ! In Ewigkeit ! » ((Lulu ! mon Ange ! Laisse-moi te voir encore une fois ! Je suis près de toi ! Je reste près de toi ! Pour l’éternité !)).
On comprend alors, appuyé sur le texte-même de Berg, que le concerto « à la mémoire d’un ange » serve de Requiem à cet autre ange qu’est Lulu, qui donne sens à l'entreprise, car c’est bien ce troisième acte étonnant qui par ricochet, éclaire toute l’entreprise.
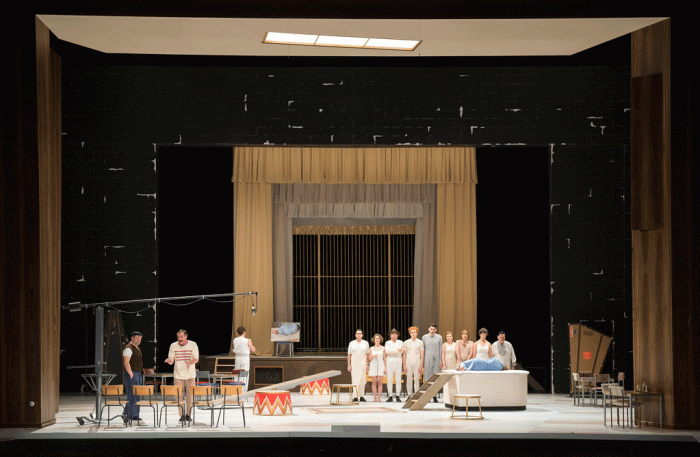
Dans la ménagerie initiale citée dans le texte de l’œuvre par le Tierbändiger, c’est tous les personnages qui sont présentés sous couvert d’animaux sauvages ou domestiques : la vie est ce cirque où évoluent tous les animaux du cirque humain. Le décor (d'Anna Viebrock, qui signe aussi les costumes) est donc une arrière-salle, une trace de cirque ou de Music-Hall, avec tabourets et tremplin, scène au fond, et des murs qui semblent inscrire des décors futurs, une scène ouverte, presque inachevée donc, quant aux personnages, ils sont vêtus comme des artistes de cirque à l’entrainement, dans leurs caleçons blancs, comme inscrits eux aussi dans une sorte d’inachèvement de leurs numéros.
Deux éléments frappent dès l’abord : d’abord, les personnages sont amenés devant une jeune femme dormante (c’est Lulu), dos au spectateur et vaguement recroquevillée, ils la regardent de manière à faire comprendre que « l’importance est dans le regard et non dans la chose regardée » ((Que l’importance soit dans ton regard et non dans la chose regardée (André Gide, Les nourritures terrestres) )) . C’est le regard qui va être déterminant dans ce travail, un regard qui crée le personnage, dans lequel se projettent désirs et fantasmes, et Marthaler va en jouer sans cesse ; en avant-scène, une perche portant un micro, comme pour un enregistrement, comme pour, déjà, une représentation, comme pour déjà éloigner tout naturel et tout naturalisme, avec en arrière scène, cette scène de théâtre dans le théâtre, justement le lieu où l’on regarde : du verbe grec Θεάομαι, visionner, regarder, admirer…

Ces jeux croisés de vision, de regards et d’admiration se relient au fameux portrait, sorte de fil rouge de l’œuvre, qui se multiplie en autant de regards, toujours les mêmes et toujours différents, un portrait de femme retournée, qui se dérobe et habillée d’une légère robe de chambre couleur ciel ((que les femmes ombres qui parcourent la représentation porteront aussi au second acte, en autant de répliques de Lulu)), une femme retournée comme si elle était antithétique de ces portraits célèbres de femmes qui s’exhibent effrontément en objet désirable : Venus d’Urbino du Titien, Maja desnuda de Goya ou Olympia de Manet. Cette femme, tournant le dos au spectateur, tournant le dos à l’œil du peintre, tourne le dos au désir.
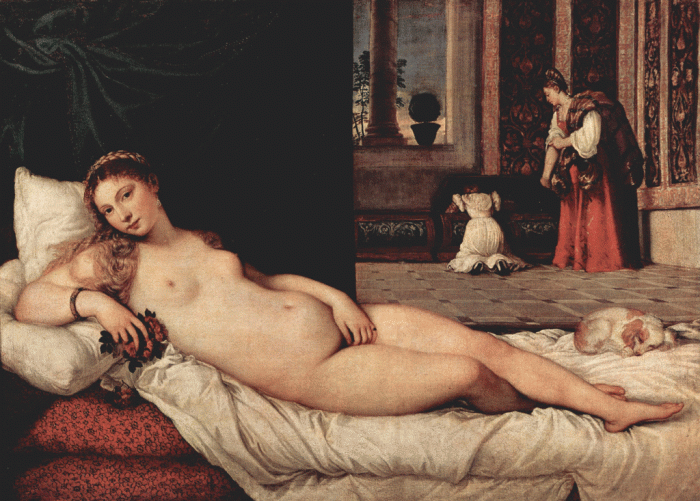
Ce jeu sur le regard est encore souligné au 2ème acte, car le regard du spectateur-voyeur est cette fois-ci encore plus filtré. Le décor du deuxième acte est une vaste cabine d’enregistrement insonorisée, dont on retrouve le micro du 1er acte, un cadre devant lequel trois tables et trois chaises sont installés, d’où à travers une vitre on observe au premier plan un escalier de grande maison bourgeoise, et à l’arrière-plan la scène du premier acte : de ce décor de second plan, des images, des personnages qui passent ou qui montent ou descendent, une sorte de studio où se déroule en arrière plan un film muet qu'on sonorise, peut-être comme si la Lulu de Pabst était prolongée par l'opéra de Berg qui en serait la sonorisation ((La composition de Lulu de Berg commence en 1929, année de la sortie du film)).
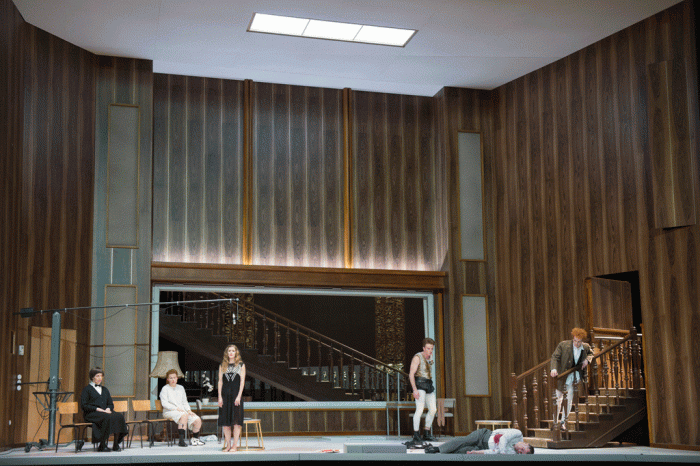
Pendant qu’au premier plan se déroule comme la pantomime de l’acte 2 : une pantomime d’où toute angoisse, toute violence, tout drame sont effacés ou dilués, ou embrumés ou diffractés par ces filtres qui empêchent tout regard direct, qui séparent monde de représentation second (derrière la vitre) et monde de représentation premier (en deçà) où ce qui se passe n’a rien de réaliste, encore moins réel. On tourne le dos à l’expressionnisme pour entrer dans une sorte d’univers pictural de personnages qui pourraient entrer ensuite dans un tableau de Matisse ou un univers de pantins et marionnettes. C’est encore plus clair au moment où Lulu tire sur Schön comme un jeu d’enfants pan-pan à un moment du livret où ce tir n’est pas prévu, mais qui devient alors pur jeu, mouvements de théâtre, difficultés pour Schön à s’écrouler, petit trou rouge au côté droit qui fait signe, mais qui ne fait pas drame. Pantomime de mort comme pantomime de tir. C’est cette idée de pantomime, au sens où l’entendait la Foire au XVIIIème siècle, c'est à dire alternative à l'opéra ou au théâtre, qui me poursuit quand j’essaie de qualifier l’entreprise complexe de Marthaler et Nagano, devenue pantomime réelle pendant les 25 dernières minutes, où l’exécution par une magnifique Veronika Eberle du "Concerto à la mémoire d’un ange", s’accompagne d’une sorte de danse de jeunes filles qui pourraient être ces jeunes filles-anges qui attendent Lulu et que celle-ci rejoint, mais Veronika Eberle elle aussi devient aussi cet ange-musicien des tableaux de la Renaissance qui annoncent les joies du Paradis.
Reste le troisième acte. Un troisième acte volontairement coupé en deux, parce que l’entreprise sur l’inachèvement autorise un autre rythme, une autre scansion de l’œuvre pour lui retirer son aspect parabolique, ascension/triomphe/chute, cette fameuse construction en « arche ».
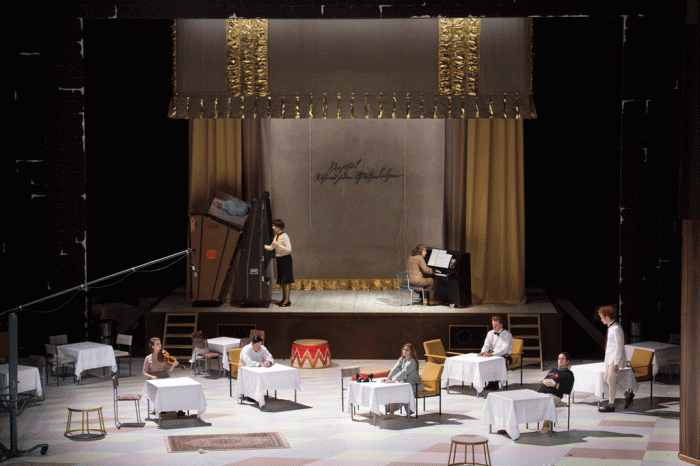
La scène I du troisième acte conclut la deuxième partie où la musique s’interrompt de manière presque fluide, pour laisser place au son grêle du violon puis des pianos et pour passer d’un théâtre rendu réaliste par la présence de l’orchestre à un théâtre évaporé où parole et piano dessinent un univers comme dans le monde ouaté du Lied et provoquer un choc auditif qui donne au théâtre une autre nature, proche de l’effet procuré dans La Grande Duchesse de Gerolstein, qui est pour moi la référence scénique qui éclaire les racines de ce spectacle. D’une certaine manière, Marthaler et Nagano nous incitent à penser que Lulu, par la disparition même de l’orchestre, quitte le monde de l'action dramatique pour atteindre à une transfiguration poétique qui commence par la chute, non représentée comme le drame de la chute : par cette vision d’une salle de restaurant pantomimée, tout est atténué par le son et par le ton et puis arrive le martyre, qui fait la troisième partie de la soirée, et que Lulu vit là aussi dans une sorte de dramaturgie ramassée où les personnages (les clients) semblent presque tous se ressembler et où Jack entre en pull-over rouge (!) pour rapidement passer à l’acte dans une danse-étreinte macabre, unique moment de la soirée où les chairs se touchent, qui laisse Lulu étendue, poussant son cri (Nein ! Nein !) après le meurtre, comme si ce cri ouvrait son passage dans l’outre-tombe, puis au ciel angélique.
Tout drame est non effacé, mais atténué, par le jeu, par le son, pour devenir une sorte de performance artistique qui rend impossible la réduction de l’œuvre à son livret.

En composant avec l’inachèvement, Nagano et Marthaler ont opté pour une vision qui fait de Lulu un objet manipulé, une bête de ménagerie qu’on va dresser, et qui répète ses mouvements comme si le Tierbändiger l’avait éduquée à tomber puis se relever plusieurs fois (au premier acte). Évidemment, la plasticité corporelle de Barbara Hannigan et son élasticité font merveille, même si au départ on se prend à murmurer qu’elle « fait du Barbara Hannigan » tant on l’a vue sur d’autres scènes ou dans d’autres œuvres utiliser ses qualités physiques de danseuse. Mais justement, elle n’est presque pas « personnage », elle est un être ailleurs, « corps et voix » presque chosifié par ces multiples prismes de regards qu’on évoquait plus haut. Si la performance corporelle est toujours exceptionnelle, même si déjà vue, la performance vocale, avec les moyens qui lui sont propres, et qui ne sont pas énormes, reste stupéfiante, avec une science du contrôle et une manière de poser la voix qui lui permet des passages à l’aigu impressionnants. Hannigan est une chanteuse hors norme, une de ces artistes à tout faire qui remplit une scène dès son apparition, et qui fascine. Alors, il y aura peut-être des défauts (et encore…), mais pareille performance est époustouflante et laisse pantois.
Si Lulu d’une certaine manière est un personnage étouffé par ces regards croisés et la construction en abyme de l’œuvre, et que cette Lulu est moins « théâtrale » et plus « fantasmatique », décarnée oserait-on dire, Geschwitz au contraire est incarnée par Anna Sofie von Otter qui en fait une figure, au sens presque mythique du terme. Le look, la démarche, qui ne sont pas sans rappeler sa Muse dans Les Contes d’Hoffmann (il faut la voir monter l’escalier), la présence incroyable et la singulière performance vocale, intense, la fait à chaque intervention chanter un grand Lied tant elle construit par sa seule émission et par l’articulation des mots un univers qui étreint. Sa manière de chanter nous rappelle, elle seule, la vie du drame et le monde tragique, celle de la Chanson de la mal aimée. Avec des moyens et un volume qui ne sont plus ce qu’ils ont pu être, Anne Sofie von Otter est stupéfiante de tension et d’émotion. Je n’ai cessé de penser au Lied von der Erde dans une performance qui ressemble à un Abschied ((Adieu)) permanent. Un seul mot convient à cette présence exceptionnelle : grandiose.
Autour de ces deux monstres, la ménagerie est complétée par un Alwa très notable, l’excellent Matthias Klink à qui le rôle (déjà interprété à Munich notamment) convient parfaitement. Voix claire, impeccable diction (ce qui est essentiel dans une œuvre vue à la fin comme un Lied à plusieurs voix) belle projection et limpidité de l’ensemble en font aujourd’hui l’Alwa de référence : un artiste polymorphe (il fait aussi bien Le vin herbé de Frank Martin – à Berlin, que Die Nacht in Venedig de J.Strauss à Lyon ou ici Alwa) qui démontre à chaque fois un souci de rentrer de manière très intime dans les rôles, de leur donner une couleur : ici cet Alwa issu du monde des clowns (chevelure rousse agressive) est vraiment émouvant et décalé.
La mise en scène, par sa singularité donne à Schön/Jack un autre rôle que celui auquel le spectateur de Lulu est habitué : à mille lieues des figures torturées et dramatiques d’un Franz Mazura jadis avec Chéreau, ou d’un Bo Skovhus à Munich, nous avons là un Schön qui n’a rien de particulier ni de singulier, on pourrait même dire en exagérant à peine un des anonymes de la ménagerie, non que le personnage n’existât pas, mais il est comme bien des éléments de ce travail, à la fois inconsistant et présent, avec une voix plus douce que d’habitude, sans la profondeur (Mazura), ni la cassure (Skovhus), mais avec une sorte de rondeur très inhabituelle dans ce rôle. Jochen Schmeckenbecher pour qui c’est une prise de rôle réussit parfaitement à reprofiler Schön et aussi Jack dans une sorte de banalité, sinon de médiocrité, avec une voix moins acérée que de coutume, mais une vraie personnalité détournée.
Les autres personnages n’étant pas vraiment caractérisés, mais partageant une fraternité de profils et d’attitudes née de leur regard commun sur Lulu, sont tous remarquables, et dignes d’intérêt : Peter Lodahl dans Der Maler/Der Neger, comme toujours intéressant avec sa voix de ténor bien timbrée, bien projetée, et son timbre chaud, Ivan Ludlow remarquable Tierbändiger et Athlet désopilant et dérisoire, marthalérien en diable, avec une voix forte et très expressive, ainsi que Marta Swiderska, Theatergarderobiere, qui avale aussi le rôle du Gymnasiast, valeureuse mezzo de la troupe de Hambourg. Schigolch dans une telle mise en scène n’est qu’un animal de ménagerie de plus, et pas le vieillard qu’on a pu voir récemment (par ex. Mazura à Lyon ou à la Scala). Sergei Leiferkus est certes un chanteur d’une autre génération, mais le personnage voulu par Marthaler a un profil jeune et parallèle aux autres, comme s’ils étaient des variations d’un même thème.
Dans les personnages qui se profilent, on voit en fond de scène de jeunes femmes qui au premier acte sont des danseuses de Music-Hall, qui apparaissent au second comme double du portrait et qui vont au troisième exécuter la pantomime du Concerto pour violon « à la mémoire d’un ange » ; Marthaler leur donne le nom de personnages de l’original théâtral de Wedekind, qui n’existent pas en tant que tels chez Berg : Madeleine de Marelle (le nom se retrouve dans Bel Ami de Maupassant que Wedekind avait lu en 1892), et sa fille Kadéga, Bianetta Gazil, Ludmilla Steinherz sont chez Wedekind des personnages de la scène parisienne du début du troisième acte, et elles figurent ces ombres, ces errants que Marthaler utilise souvent dans ses mises en scène. Marthaler nous indique à la fois la construction d’une fidélité aux sources de l’œuvre et reste fidèle à ses images qui quelques fois désarçonnent, comme ce ballet discret aux mouvements de mains mécaniques et aux pas mesurés qui accompagnent le violon.
Deux apostilles enfin : la violoniste, qui est une concertiste bien connue ((Veronika Eberle vient de l’interpréter avec l’Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise et Yannick Nézet Séguin le 16 février 2017)), et le pianiste Bendix Dethleffsen (très lié à Marthaler) ne font pas partie de la liste des musiciens, mais des rôles (Eine Violonistin, Ein Pianist), ils sont part du spectacle et non part de la musique, part d’une musique qui est théâtre dans cette entreprise dérangeante et profondément poétique.
Car Kent Nagano a pris une option surprenante, fondée sur la notion de spectacle total qui fait de la musique le motif de la mise en scène, au sens où la réflexion des deux responsables de la production est d’abord musicale. Et c’est bien cette ouverture qu’offre l’inachèvement qui motive un vrai travail musical polymorphe où l’on passe de l’opéra traditionnel à la pantomime et où de la voix humaine on passe à celle de l’instrument qui la mime le plus, le violon ; que tout cela ait une cohérence et un sens, c’est ce que le public qui a salué très chaleureusement le spectacle a bien saisi.
Si Marthaler nous égare au départ, il nous mène ensuite dans son univers, tandis que Nagano à la tête de son remarquable Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, propose une lecture jamais froide (alors qu’on lui a souvent reproché une rigueur froide), et, tout en restant très claire, et jamais tonitruante, ni même appuyée, sa lecture n’est pas dépourvue de romantisme, voire de tendresse. La magnificence des bois et des cuivres, le suivi du plateau, très soucieux des équilibres et donnant déjà à la fosse cet aspect presque chambriste qui va envahir peu à peu la scène, le style aussi dont il accompagne de manière très soyeuse la violoniste dans le concerto final montre que la volonté est clairement de travailler le ton et l'homogénéité du spectacle, scène et fosse, plutôt que d’être démonstratif dans son approche orchestrale. Veronika Eberle propose une version très charnelle du concerto de Berg et en même temps très subtile et pleine de relief ; habillée comme les autres personnages et se déplaçant peu à peu jusqu’au centre de l’espace, faisant, par sa musique, lever Lulu effondrée, elle devient elle-même personnage de théâtre . Ce sont des moments d’une intense poésie, où Nagano fait de l’orchestre non le protagoniste, mais la part du spectacle, part irréductible, mais part seulement. Il a su surtout donner une couleur à ce travail, la couleur du rêve, de l’ailleurs, jamais expressionniste, ni appuyé mais tout en effleurement, tout en sensation et tout en sensibilité. Il nous dit, avec Marthaler que l’inachèvement de l’œuvre ouvre des espaces musicaux nouveaux qui ouvrent eux-mêmes des espaces de sens, et nous amènent à relire l’histoire de Lulu, en dissolvant le personnage et faisant de ses « victimes » ses bourreaux (c’est dans l’œuvre, évidemment), mais au lieu d’en faire initialement des victimes, Marthaler et Nagano en font dès le début des bourreaux, qui font de Lulu l’objet et non le sujet de leurs désirs, une projection aux multiples prismes. Lulu traverse ces regards et ces espaces qui sont purs espaces de jeu sans être autre chose que ce que les autres en font, sans être presque autre chose qu’un pantin désarticulé et mangé. Et à la fin, quand tous sont morts ou peu s’en faut, elle existe enfin en gagnant son paradis, accompagnée par la musique des anges avec dans les dernières mesures une citation du choral de Bach "Es ist genug"((C'est assez/ça suffit)). Quel pari !
