
Like a crushing stone
La bonne soirée entre copines vire au cauchemar. Pour se disculper, elles se déclarent victimes d’ensorcèlement. Les doutes deviennent vite des accusations. Le révérend Hale mène l’enquête. Il est bientôt rejoint par le gouverneur Danforth, véritable inquisiteur et exécuteur impitoyable à la tête d’un tribunal d’une légitimité douteuse. Bientôt, Danforth s’opposera à Dale car ce dernier a commencé à douter et se met à défendre les accusés. Ça n’empêche pas les pendaisons, et même l’écrasement de Giles Corey par les pierres. La loi d’alors prévoyait cette « peine forte et dure » lorsqu’un accusé refusait de plaider coupable ou non coupable. Corey mourut en trois jours.
Dénonciations, aveux extorqués… : l’ambiance, étouffante, est celle du maccarthysme et Arthur Miller l’indiqua explicitement. Après sa création, la pièce a été adaptée à l’opéra (Robert Ward, 1961) et deux fois au cinéma. D’abord par Jean Rouleau en 1957, avec Yves Montand et Simone Signoret dans les principaux rôles, Jean-Paul Sartre se chargeant du scénario et des dialogues, supprimant le rôle de Dale, jugé… trop sympathique, chacun a sa propre chasse aux sorcières. Ensuite, en 1996, par Nicolas Hytner, avec un sémillant octogénaire, Arthur Miller en personne, comme scénariste.

Retour au texte d’origine, dans la petite salle de l’Espace Cardin, avec une mise en scène d’Emmanuel Demarcy-Mota où l’on notera à peine le recours bref et anachronique à un téléphone portable. L’adaptation, il est vrai, ignore la reconstitution historique, décors et costumes se jouant des époques. Pour se concentrer sur l’univers fantasmagorique de la forêt, cœur initial du drame, que la vidéo ne cesse de restituer en ombres mouvantes, les silhouettes des arbres dessinant au fond une manière de rond de sorcières. Au premier plan, une toile y ajoute le flou d’une brume, fantomatique.

Elle s’écarte parfois, pour rendre plus crue la lumière, lors des interrogatoires par exemple. Les intérieurs sont campés en quelques accessoires mais leur disposition, soigneusement agencée, et l’incessant travail des lumières définissent précisément les lieux qu’ils évoquent : forêt donc, intérieurs frustes, cabanes de bûcherons, tribunal aux allures d’église gothique, échafauds alignés et superposés qui sont autant de cellules où les prisonniers attendent leur exécution.
Près d’une quinzaine de comédiens campent ici ces communautés de Salem, déchirées par l’hystérie collective. Le couple des Proctor s’impose ici, par sa droiture, morale plus que puritaine. A la douceur rigide de Sarah Karbasnikoff répond la rugosité de Serge Maggiani.
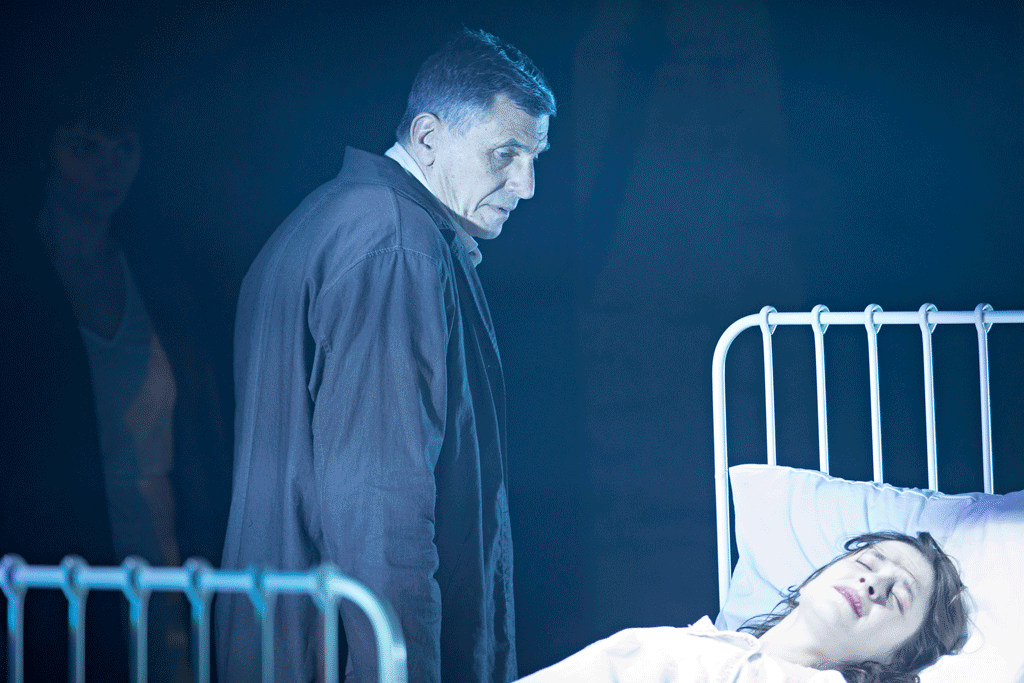
Elle ment pour le sauver, et sa chute dit aussitôt combien ce mensonge lui a coûté. Le voici confronté à une double faute : l’adultère et l’épouse assez aimante pour mentir à un tribunal. De défenseur d’une cause, John Proctor passe à l’époux repenti, bouleversé, soudain fragile, avec les nuances d’une présence scénique tout en hauteur, combative, lors même qu’elle se courbe devant ses bourreaux.
Hale est pavé de bonnes intentions
Autre couple, mais janusien, celui formé par Hale et Danforth. Au premier, Philippe Demarle prête une voix à l’accent prononcé, et une diction soigneuse, doucement martelée, puis l’énoncé d’abord hésitant puis plus ferme du repenti. Il se heurte, comme tout Salem, à la violence sèche, brute et sonore de Jauris Casanova dont le Danforth ignore le doute ou même l’apitoiement. La parole de Dieu circule entre eux, comme une interrogation de la foi.
« HALE
Durant ces trois mois, j’ai cherché s’il existait un moyen chrétien de condamner la damnation. Je me suis demandé s’il était permis à un ministre de Dieu d’exhorter des innocents à faire un mensonge pour sauver leur vie.
HATHORNE
Monsieur Hale, il ne s’agit pas ici de faire un mensonge.
HALE
Si ! un mensonge ! Ils sont tous innocents ! (A Elisabeth.) Ne vous trompez pas sur votre devoir comme je me suis trompé sur le mien. Pensez‑y bien, c’est au nom de la morale et de la religion que je suis devenu un meurtrier. Ne vous attachez donc pas à des principes si ces principes doivent faire couler le sang. C’est justement une loi trompeuse que celle qui nous conduit au sacrifice. La vie est le plus précieux des dons de Dieu, et rien ne donne le droit à personne de l’ôter à un être. Je vous en prie, femme, insistez pour que votre mari avoue. Laissez-le mentir. Ne tremblez pas devant le jugement de Dieu, car il se peut que Dieu punisse les menteurs, mais Il sera sans miséricorde pour ceux qui auront fait abandon de leur vie par orgueil. »
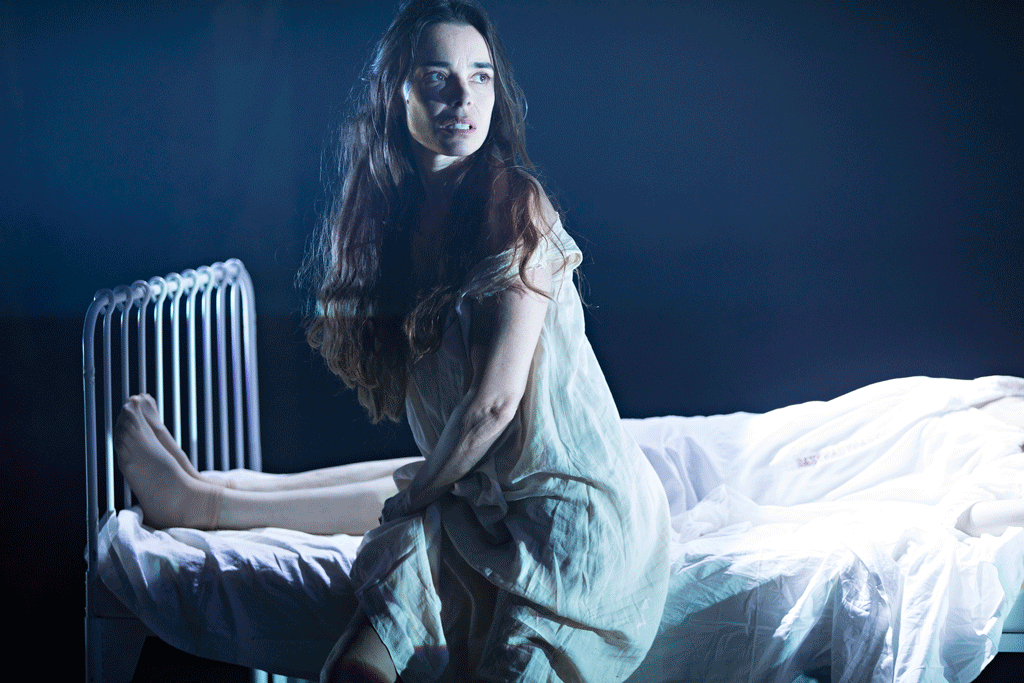
À Abigail, Élodie Bouchez apporte une forme d’hébétude, qui cède un peu trop souvent la place à la gestuelle convenue de la transe. Elle s’avère plus convaincante dans les bras de John Proctor, amoureuse déçue et perverse. Grace Seri campe admirablement le personnage de Mary Warren, esclave devenue accusatrice, métamorphose magistralement rende en quelques instants, par le récit anodin d’abord, puis triomphant d’une journée au tribunal où, par ses dénonciations, elle a pu se libérer de ses chaînes. L’ensemble de la distribution est de fait à saluer, par la restitution non pas fidèle, puisque transposée, mais crédible de ce crescendo infernal où chacun doit s’inscrire et se perdre, dans une approche chorale.
Malgré ces talents, le spectacle laisse un goût d’inachevé. La pièce, sans doute, est datée et a perdu de sa force ; trop démonstrative parfois, ou bavarde, elle peine à émouvoir, par son propos trop écrit et finalement assez peu charnel. A l’heure des lynchages éclair des réseaux sociaux, il y avait sans doute de la place pour une adaptation plus alerte, moins poétique sans doute mais qui aurait redonné de la vigueur au texte.
