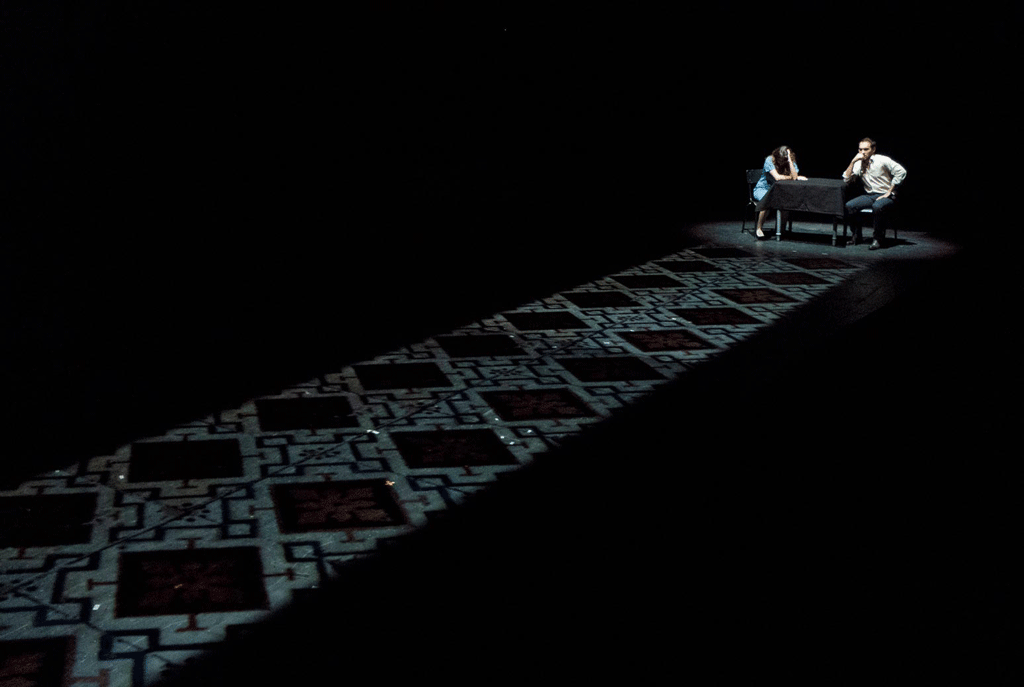« Je ne sais pas très bien comment parler de cette pièce. Pourtant elle est relativement simple. C’est une suite d’instants sans unité déclarée ou cohérence narrative. Elle ressemble plus à une succession de petits fragments fictionnels, comme des nouvelles, sur un thème à peu près commun » C’est en ces termes que Joël Pommerat évoque La Réunification des deux Corées dont le titre singulier retient déjà l’attention. A l’entrée en salle, guidé par le personnel du TNP, on est frappé par le dispositif bifrontal choisi et par le couloir imposant qui sépare les deux gradins qui se font face. L’auteur metteur en scène choisit manifestement de s’écarter des sentiers balisés, optant pour une forme tout en étrangeté alliant le texte et l’espace dans lequel il est mis en scène. Car il en va de l’étrange, comme le souligne délicatement cette brèche centrale, ce couloir sombre et vide, alors que la salle se remplit, séparant le public en deux. Comme deux Corées à distance l’une de l’autre, d’emblée. Comme deux zones immuablement séparées de part et d’autre d’une fente nette, par-delà laquelle on se voit sans se regarder vraiment. Ce long couloir est borné par les ombres du hors-scène dissimulant à notre vue comédiens et techniciens, dans les coulisses comme autant de ténèbres qui vont jeter dans la lumière chaque saynète juste avant de l’engloutir à nouveau.
Au-delà de l’espace comme un lieu indéfini, la mise en scène propose un traitement particulier du temps. Chaque « fragment » est un surgissement comme une brève déflagration visuelle se déroulant de façon autonome, sous nous yeux. Il y a quelque chose du mirage dans ces apparitions fulgurantes, là, sur ce plateau-ligne de faille qui pousse la chronologie à la rupture. Chaque fragment figure un présent éternel, chaque action est en perpétuel accomplissement. Ce sont vingt éclats de vie, vingt passages obscurément délimités dans le temps, sans cesse réactualisés au fil des représentations. Loin de chercher à reproduire la clarté naturelle et réaliste du jour et de la course du temps, les projecteurs font plutôt apparaître au sol des motifs recherchés évoquant par exemple, les ombres mouvantes d’un feuillage sous une mystérieuse lune ou encore le carrelage suranné d’une maison bourgeoise. Soulignons ici le raffinement avec lequel le travail sur la lumière est exécuté au fil du spectacle, travail qui n’est pas sans rappeler l’univers du cinéma : certaines saynètes s’achèvent par la fermeture progressive d’une découpe comme un fondu au noir, comme une allusion discrète aux premiers films. Aux images qui se fixent comme on écrit pour conserver la mémoire des Hommes. En somme, au croisement du réel et de l’abstrait, le lieu n’est pas vraiment un lieu, le temps n’est pas vraiment un temps et à cet égard, on songe aux mythes fondateurs de l’humanité. C’est ainsi que commence le défilé de ces personnages mis en présence des autres, comme autant de brefs récits mythologiques à se remémorer inlassablement.

Les personnages, portés par des comédiens tous formidablement engagés et les faisant apparaître stricto sensu suivant de rigoureux enchaînements, n’ont que rarement une identité, exception faite du « mariage » par exemple, où dans un rocambolesque échange Christian, le futur marié, est accablé d’abord par Caroline, la sœur jumelle de Christelle la future mariée. Caroline veut empêcher leur union parce que « ça va à l’inverse des lois naturelles », parce qu’elle aime Christian et qu’il l’aime aussi selon elle, puisqu’ils ont échangé un baiser. S’ensuit l’arrivée des trois autres sœurs soucieuses du retard des futurs époux. Au fil d’un conseil de famille de dernière minute pour sortir de la crise, aussi enflammé que désopilant, chacune d’elles finit par reconnaître avoir été un jour embrassée par Christian. Le mariage est annulé et restent dans la brèche, sous les yeux des spectateurs, Christian et Myriam, la seule des sœurs déjà mariée qui conclut sur la prise de conscience d’une déception : « En fait c’est con mais j’ai toujours regretté que ça n’aille pas plus loin entre nous deux. »
Comme celui-ci, chaque instantané va mettre à jour sous les yeux des spectateurs, les rapports humains, les liens amoureux dans ce qu’ils ont de plus complexes voire de plus contradictoires quelquefois. Joël Pommerat et ses comédiens interrogent ce qui unit les êtres, ce qui les séparent simultanément aussi. Ils soulignent avec justesse la difficulté à dogmatiser le sentiment pour l’Autre mais se proposent plutôt d’en explorer le champ des possibles. Convoquant le mythe platonicien de l’androgyne primitif, La Réunification des deux Corées met en présence des êtres qui en cherchent d’autres et par essence, vivent – ou survivent – en état de manque.
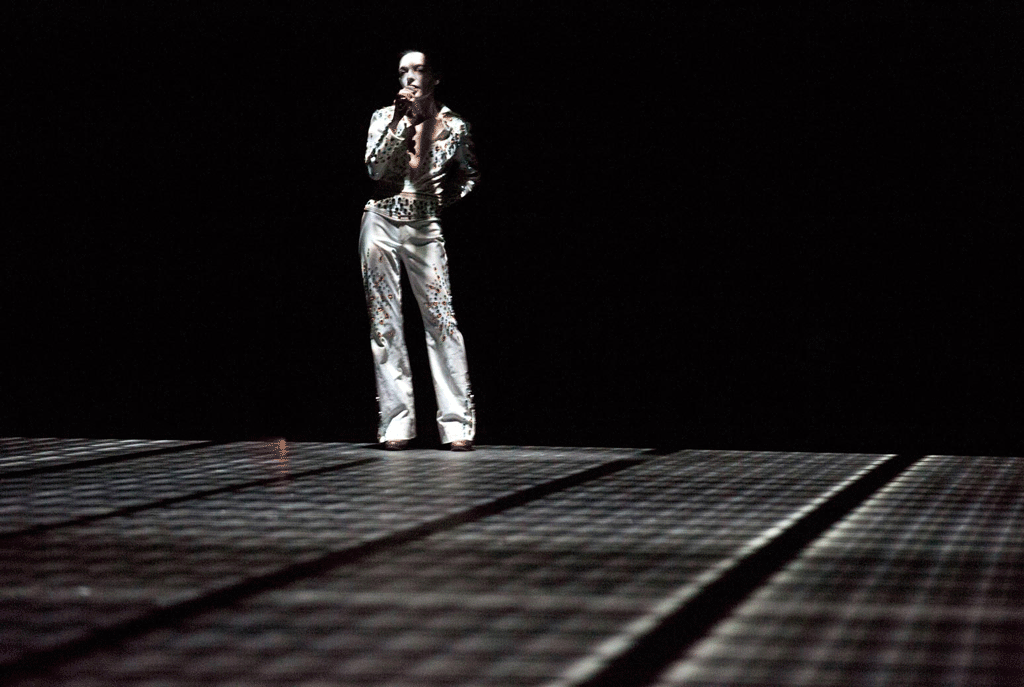
Incarnée par la lumineuse Agnès Berthon, la figure gracile très glam rock, à la voix mâle et grave se dressant à plusieurs reprises sous les spotlights tel un hologramme de David Bowie, rappelle le récit d’Aristophane dans Le Banquet. Le mythe une fois encore. Comme un fil conducteur pour mieux faire voir.
L’amour ici est inextricablement lié au manque, avec le désir de l’Autre qui peut combler ou qui pourrait combler suivant ce qu’on se raconte pour s’en persuader. Il est lié à la séparation aussi. Et renvoie à soi-même en définitive. C’est, dans la toute première saynète, la femme qui répond à une voix féminine et affirme qu’elle « préfère cette solitude à cette absence d’amour », seule, à un bout du plateau-ligne de faille. C’est plus loin, une autre femme qui hurle à sa compagne « Rends-moi cette part de moi que tu as gardé en toi » et qu’elle essaye de lui arracher physiquement, basculant dans la violence. C’est la prostituée qui interpelle celui qu’elle aime et qui la quitte, en l’interrogeant « Mais moi ? Je suis qui ??? […] un orifice ? »

C’est aussi cet homme et cette femme qui endurent les ébats de leurs conjoints respectifs plus loin, dans la cage d’escalier, assis dans deux fauteuils – bouleversants Marie Piemontese et Philippe Frécon – et qui en arrivent à la conclusion terrible et merveilleuse qu’ils sont « proches finalement » , dans cette douleur qui les rassemble. C’est le couple désespéré qui se créent de « faux » enfants à faire garder par une baby-sitter quelconque pour continuer à exister, par peur de devenir « comme deux étrangers, deux fantômes l’un à l’autre » ce qu’ils disent redouter « comme la mort ». Yannick Choirat est très émouvant dans le rôle de l’homme qui se débat pour tenter de sauvegarder l’apparence de son couple « qui prévient les autres de notre, de votre existence » même si on n’a « rien à se dire de vraiment important ». Enfin, c’est cet autre couple qui marche de long en large, d’un bout à l’autre du plateau-ligne de faille : la femme – Agnès Berthon – a perdu la mémoire et, comme une nouvelle référence à ce présent perpétuel, son mari – Philippe Frécon – lui répète les mêmes choses à chaque visite : leur histoire commune, leurs enfants, leurs relations sexuelles. Et elle de s’étonner : « Ah bon ? » Jusqu’à ce que dans un cri de dépit, il lui exprime avec véhémence leur rencontre – « c’était parfait » – leur union – « c’était comme si la Corée du Nord et la Corée du Sud ouvraient leurs frontières et se réunissaient ». D’une grande justesse, les deux comédiens campent un homme et une femme qui, à travers un dialogue de sourds en raison de l’amnésie de cette dernière, réaffirment continuellement cette difficulté d’aimer. Celle qui déchire intérieurement car, comme un autre personnage le revendiquera aussi, « l’amour, ça ne suffit pas » : il faut supporter le manque. Alors, on est condamné à l’errance dans la brèche, à se tourner autour comme les autos tamponneuses qui ne parviennent même pas à se percuter dans un autre fragment presque muet tout à fait réussi.
Au bout de presque deux heures de spectacle, les applaudissements sont très nourris. Nous avons ri – un peu jaune parfois – nous avons été touchés – souvent – et sans doute nous sommes-nous reconnus par-delà la brèche qui a fonctionné tel un miroir en fin de compte. Parce que le théâtre de Joël Pommerat est fondamentalement humain, il nous parle de nous. Quittant la salle, on peut d’ailleurs se demander si ce n’est pas un discours qui nous manque aujourd’hui, cruellement parfois, et que nous venons chercher, réunis – plus que réunifiés – au théâtre. Et animés d’un grand désir d’humanité.