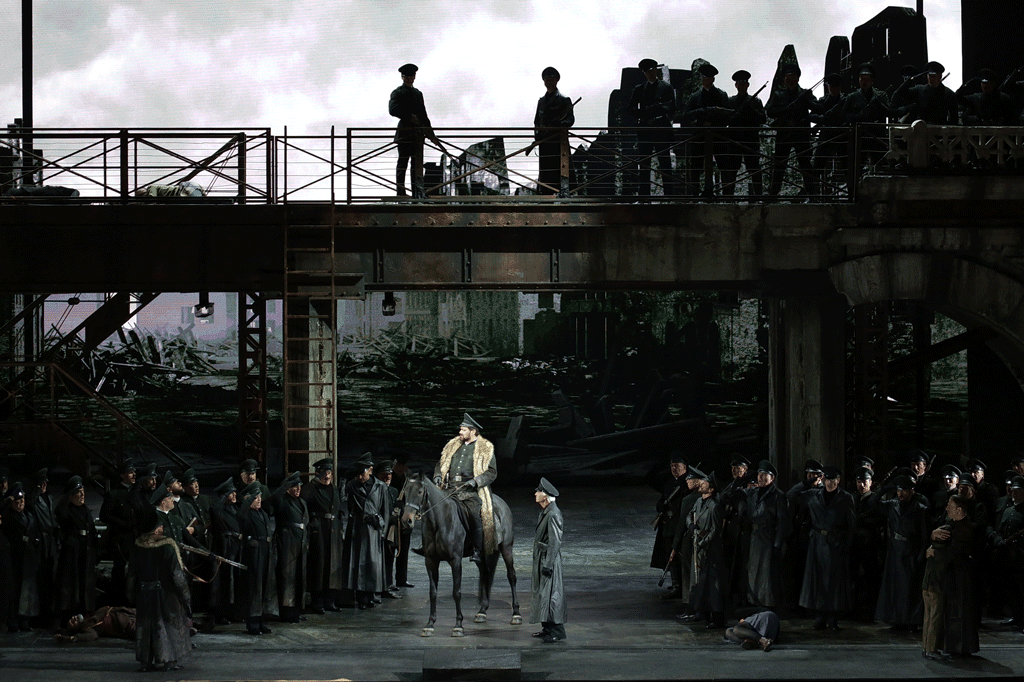
Retour à l'Italie
Cette production d’Attila répond à la politique volontariste de Riccardo Chailly qui cherche à imposer de nouveau un répertoire « maison », du côté de Puccini, du vérisme, et de ces opéras de Verdi moins représentés, dont les opéras dits « du jeune Verdi » ; en 2015, ce fut la très rare Giovanna d’Arco, non représentée à la Scala depuis 1865, et en 2018, c’est au tour d’Attila, plus fréquent et dont la dernière production locale (de Gabriele Lavia) remonte seulement à 2011, mais tout le monde l’a oubliée (c’est dire !) alors que celle de Jérôme Savary dirigée par Muti avec Samuel Ramey en 1991 est encore dans les mémoires.
Cette saison, pour continuer la redécouverte, Michele Mariotti dirigera I masnadieri, plus rare qu’Attila d’ailleurs, et pour rassurer les inquiets, Chung reprendra l’éternelle Traviata de Liliana Cavani, ((tandis que la géniale production de Dmitri Tcherniakov, fine, intelligente et bien réalisée, est tombée au champ d’honneur des productions trop avancées pour le public local )) , enfin l’équipe des jeunes de l’académie entourera Leo Nucci pour une reprise du Rigoletto de Gilbert Deflo. Quatre Verdi, deux standards, et deux œuvres plus rares .
Du grand spectacle
La production de Davide Livermore, dont on a vu Don Pasquale la saison dernière correspond exactement à ce qu’on attend d’une production inaugurale. Avec ses compères de Gio Forma, il a conçu un décor monumental, qui remplit la scène, avec notamment au début des changements à vue impressionnants, des chevaux, des camions : le public en prend plein les yeux. Tout cela renvoie d’abord à des visions de désolation très inspirées de Roberto Rossellini : la première image, un champ de ruines fumantes, est d’ailleurs l’une des plus réussies, avant que la scène ne se remplisse un peu trop. À cela s’ajoutent des éclairages (d'Antonio Castro) contrastés quelquefois d’un rouge agressif et sanguinolent, le tout se référant à l’univers de bandes dessinées à la Edgar P. Jacobs. Le spectacle nous dit que la guerre, c’est vilain et que cet Attila est un vrai barbare : ses soldats tirent sur tous ce qui bouge, et notamment les civils, femmes enfants, sans pitié, d’une manière tellement caricaturale qu’on peut imaginer un peu, rien qu’un peu d’ironie derrière : par exemple on n’entend pas les coups de feu, mais on voit les éclairs du tir – encore la bande dessinée.
Visuellement c’est au total techniquement réussi mais très lourd et très chargé.

Pour donner à l’ensemble une couleur « moderne », Livermore a transposé cet Attila dans l’univers des années 40 (beaux costumes de Gianluca Falaschi) , où une Italie oppressée (Foresto et Odabella brandissent le drapeau italien avec fierté et de manière répétitive) est l’objet d’un envahisseur sauvage aux allures singulièrement germaniques. On s’abstiendra de commenter les libertés prises avec l’histoire, à moins que les « partisans » (Odabella, Foresto) ne s’attaquent à l’ultime avatar du fascisme qu’est la République de Salò : la fête chez Attila de l'acte II, avec son passage du Veau d’or, ses prostituées et ce monde qui tombe en décadence orgiaque n’est pas sans évoquer en (beaucoup) plus « gentil » l’univers pasolinien des « 120 journées de Sodome ».


Manque de dramaturgie et de caractérisation des personnages
Si l’utilisation des vidéos est assez séduisante (réalisation D‑wok), il y a peu d’idées dramaturgiques : les personnages sont caricaturaux, les relations entre eux peu travaillées, et le personnage assez ambigu d’Attila n’est pas fouillé. Car l’un des points qui à mon avis fait problème dans cette lecture manichéenne, c’est que Verdi et Piave ne font pas d’Attila ce monstre sanguinaire après le passage duquel rien ne repousse – légende bien enracinée en Occident, alors qu’Attila en Hongrie est une légende positive, en témoignent la fortune du prénom qui s’étend même en Turquie et en Asie. De fait chez Verdi, qui dépeint rarement des personnages tout blancs ou tout noirs, dès le début Attila est plutôt assez bien disposé, notamment avec Odabella, et laisse les romains libres, comme d’ailleurs l'histoire nous dit qu'il laissa en place les rois conquis, à condition qu’ils lui jurent fidélité. Et de tous les protagonistes, c’est Ezio le "romain en eau trouble" le plus ambigu, cherchant la négociation avec Attila pour garder le pouvoir sur Rome, et toujours à la limite de la trahison et du double jeu, en vrai politicard de basse espèce, même s'il semble se racheter à la fin. Attila est plus loyal et plus noble : à la fin lorsqu’il dit à Odabella qui le poignarde « E tu pure Odabella », il y a là une expression évidemment référencée à l’assassinat de Jules César (("Tu quoque mi fili ! "(toi aussi mon fils) que dit Jules César à Brutus qui lui donnait l'ultime coup de poignard)), mais en même temps à une relation plus sensible et plus humaine à Odabella qu'il aime parce qu'il la reconnaît comme son égale ; Attila dans cette œuvre n’est pas le personnage le plus négatif, mais la mise en scène reste hélas sur l’illustratif sans fouiller la dramaturgie et passe sur ce qui pourrait nourrir une dramaturgie…
Alors, dans ce cadre où les chanteurs restent sans vraie direction, il y a une mise en images, un propos liminaire, mais rien de plus. On cherche à séduire en impressionnant, mais sans aller plus loin.
Distribution solide, dominée par Ildar Abdrazakov
Musicalement, il faut d’abord saluer le travail du chœur de la Scala, dirigé par Bruno Casoni, qui montre une fois de plus son niveau, l'énergie, le volume, la clarté de la diction, l'émission : pour sûr, il reste l’une des références mondiales des grands chœurs d’opéra. Il est ici particulièrement impressionnant, c’est l’un des points les plus positifs de la soirée.
Si Attila est un opéra spectaculaire, avec des chœurs importants, ce n’est pas un opéra épique. Peu de personnages se partagent le plateau, les quatre protagonistes Odabella (soprano), Attila (basse), Foresto (ténor) et Ezio (baryton) avec deux rôles de complément d'ailleurs bien tenus, Uldino l’esclave d’Attila (le ténor Francesco Pittari) et le pape Leone (la basse Gianluca Buratto).

Fabio Sartori
Foresto est Fabio Sartori, un ténor qui dès ses débuts s’est fait remarquer par un timbre clair et un vrai contrôle sur la voix. Des qualités dont il fait encore preuve dans Foresto. La voix est puissante, la technique correcte, le chant toujours juste, ce qui n’est pas toujours le cas chez lui, avec une vraie ductilité. Avec Abdrazakov, c’est sans doute la voix la plus convaincante de la soirée. Mais scéniquement il reste un peu pataud et n’a pas le côté juvénile et énergique que ce jeune Foresto engagé dans la guerre contre Attila et patriote devrait montrer : il lui manque le charisme demandé par le rôle, mais sa prestation est vraiment convaincante.

George Petean
L’Ezio de George Petean est lui aussi solide. On connaît les qualités du baryton roumain, à commencer par une diction parfaite, un phrasé exemplaire, un style très dominé : tout cela est impeccable et Petean de ce point de vue est irréprochable. Il lui manque cependant un peu de charisme scénique, comme Sartori, mais il manque aussi à ce chant un peu de vibration et de vie : la prestation est techniquement sans reproche, mais ne transmet pas de véritable engagement et reste un peu incolore. Enfin le rôle est d’un format un brin supérieur aux possibilités vocales, autant son air du II, 1 « dagl’immortali culmini » est parfaitement contrôlé et exécuté avec un soin jaloux à ciseler les mots, autant la cabalette du II,4 « È gettata la mia sorte » chantée avec le Da capo, gagnerait en fluidité et énergie et le passage à l’aigu final (non écrit) sur « piangerà » fait sentir qu’à ce moment le chant n’est pas si naturel. Ce sont des détails sur une prestation de très bon niveau d’un chanteur plutôt régulier, plutôt fiable, plutôt élégant mais qui n’arrive pas à « sauter le pas » vers les prestations définitives tout simplement parce qu’il n’arrive jamais à assez de couleur à son chant, toujours un peu plat.
Saioa Hernández
Le rôle d’Odabella est chanté par la jeune Saioa Hernández. 27 ans auparavant l’Odabella de Cheryl Studer fut copieusement huée dans cette salle. Un rôle redoutable à la manière d’Abigaille et de Lucrezia Foscari, un rôle épique, demandant de la tension en permanence, qui s’ouvre sur un air suicidaire « Santo di patria indefinito amor ! ». La voix a incontestablement du corps, beaucoup d'assise et d'appui, bien projetée, très homogène ; la diction est claire, mais elle manque là-aussi de vibration et de couleur. Le chant reste froid malgré l’engagement voulu par le rôle. C’est évident dans la romance « Oh nel fuggente nuvolo », chantée sans problème technique mais sans grande chaleur.
Deux remarques à son propos, d’une part les tempi adoptés par le chef et son contrôle serré expliquent peut-être ce chant puissant qui ne décolle pas et d’autre part, on peut imaginer ce que peut représenter sur un jeune soprano de chanter un tel rôle à une ouverture de saison de la Scala alors que jusque-là elle n’a chanté que dans des théâtres de moindre importance : pour sûr elle n’a pas encore la sveltesse scénique et musicale voulue, mais elle a largement de quoi progresser très vite. Attendons.
Ildar Abdrazakov
C'est la prestation d'Ildar Abdrazakov la plus convaincante, qui sans atteindre la perfection jadis d'un Ramey, montre qu’il est aujourd’hui l’Attila du moment. La voix s’est étoffée, avec une assise plus forte, des aigus parfaitement tenus et amenés, avec un spectre élargi du grave toujours superbe et des aigus mieux tenus et plus puissants montrant une homogénéité vocale enviable et avec des moments de retenue et d’intériorité plus marqués (l’aria "Mentre gonfiarsi l'anima" où il raconte l’apparition du spectre) alternant avec l’héroïsme, car la cabalette qui suit est un moment épique superbe qui fait fondre la salle. Abdrazakov n’a pas de rivaux actuels dans le rôle, qu’il domine par le phrasé, l’émission, l’intensité, mais aussi la variété des tons et des couleurs, qui lui permettent de rendre la complexité du personnage, plus humain qu’il n’y paraît comme on l’a vu.
Une direction musicale qui n'arrive pas à totalement convaincre
Riccardo Chailly utilise l’édition critique d’Helen Greenwald à la Chicago University Press et peut-être les tempi – comme pour le Rigoletto romain de Gatti- sont-ils plus lents que l’habitude : c’est en tous cas ce qui frappe d’emblée dans une exécution parfaitement au point avec un orchestre de la Scala des grands jours. À ce tempo notoirement ralenti correspond une certaine lourdeur qui donne l’impression qu’on ne s’envole jamais, même au moment des grands concertati comme celui qui clôt le premier acte. Cet Attila est compact et manque un peu de respiration : l’air n’y circule pas , non plus que les rythmes auxquels on nous a habitués, et que restituait si bien Daniele Rustioni à Lyon en 2017. Il en résulte une exécution qui ne s’envole jamais, tout en étant techniquement au point, sans reproche, mais sans joie.
Il faut s’accoutumer cependant à ce Verdi sombre, notable dès le prélude, puissant et très réussi, et une interprétation générale très concentrée, qui rompt avec une certaine tradition. Contrairement à d’autres productions, Chailly dirige avec un volume moindre, cherchant à soutenir les voix (par exemple dans l’air d’entrée du premier acte « Oh nel fuggente nuvolo » que l’orchestre accompagne avec grande délicatesse). Le troisième acte est sans doute le plus réussi avec notamment un prélude sombre et retenu suivi d’un air de Foresto magnifiquement accompagné au relief instrumental marqué (l’orchestre est ici merveilleux). Il y a dans ce travail des éléments vraiment exceptionnels, d’autres qui surprennent et d’autres qui agacent : on n’en sort pas pleinement convaincu.

