
Après Londres, Barcelone, Amsterdam, Rome, Paris est la cinquième étape de ce Berlioz-Circus à la sauce à la menthe signée Terry Gilliam. Disons-le tout de suite : Il faut au spectateur un sacré appétit pour dévorer ce monument d'humour et de notes. La faute en premier lieu à Berlioz lui-même, lancé tête baissée dans une première tentative d'opéra qui tient plus du brouillon que d'autre chose, oubliant en chemin le goût de l'époque pour des personnages caractérisés par des airs incontournables qui permettent de les identifier. Si ce dialogue chanté continu a pu déplaire à la création, ce serait aujourd'hui le livret de Léon de Wailly et Auguste Barbier qui peine à faire oublier sa minceur et finit par emporter l'œuvre par le fond. Quelle carrure donner aux amours de Cellini et Teresa, quand l'intrigue tire en même temps du côté de la commande du Persée par le Pape Clément VII, la rivalité avec Fieramosca et le meurtre involontaire de Pompeo qui contraint Cellini à accélérer la livraison de la commande, faute de quoi il finirait au bout d'une corde ?
Terry Gilliam connaît bien son Berlioz. On peut même dire qu'il officie dans la lignée des hérauts de la perfide Albion qui surent donner en leur temps au compositeur français des lettres de noblesse que – paradoxalement – il peinait à conquérir de ce côté-ci de la Manche. Pensez donc : L'œuvre a été créée en 1838 et il aura fallu attendre 1972 (Production Paul-Emile Deiber) puis 1993 (Production Denis Krief) pour la revoir sur une scène parisienne. Faisant fi des frontières géographiques et esthétiques, le blog du Wanderer avait rendu les armes devant une représentation amstellodamoise… dont il saluait justement l'ambiance de "saturnale permanente". Est-ce l'effet d'une première ou le sentiment de déjà-vu ? cette explosion du carnavalesque remplit jusqu'à la saturation les yeux et l'esprit soumis à un pilonnage de gags réglés comme des orgues de Staline. Tandis que les confettis multicolores pleuvent sur un public ébahi, masques, acrobates, jongleurs et marionnettes géantes défilent sur la scène et dans la salle. Le grand vaisseau de Bastille a des airs de taverne délirante, croquée par un Tex Avery sous amphétamines qui fait de grand œuvre berliozien une perpétuelle "saturnale". Ce contraste de couleurs est rendu particulièrement saisissant par la présence d'une gigantesque toile de fond représentant les Carceri d'invenzione de Piranese. Cette représentation renvoie ici à un sous-sol infernal, dédale en grisaille figurant les forges infernales de Benvenuto Cellini installées dans les profondeurs de Rome.

La tête et les jambes et…
Monumental, oui. Ce délire est taillé dans le marbre d'une superproduction qui ne se cache pas derrière son petit doigt pour produire ses effets. C'est la voie adoptée par une mise en scène qui a parfaitement compris qu'on ne pouvait pas prendre au sérieux une œuvre qui n'a de sérieux que l'arrière-fond de vérité historique. Berlioz fait son Grand Opéra, du moins les ressorts dramatiques et l'esthétique tératomorphe. Au milieu de ce tourbillon visuel, on saisit par le pantalon un Cellini-Astérix, on attrape par la mèche bicolore le Fieramosca de Walt Disney ou la Teresa-Cendrillon… sans parler du Pape Clément VII dont l'apparition est empruntée à celle de Paul VI dans Roma de Fellini((et à l'entrée de Cléopâtre à Rome dans le film de Mankiewicz)).
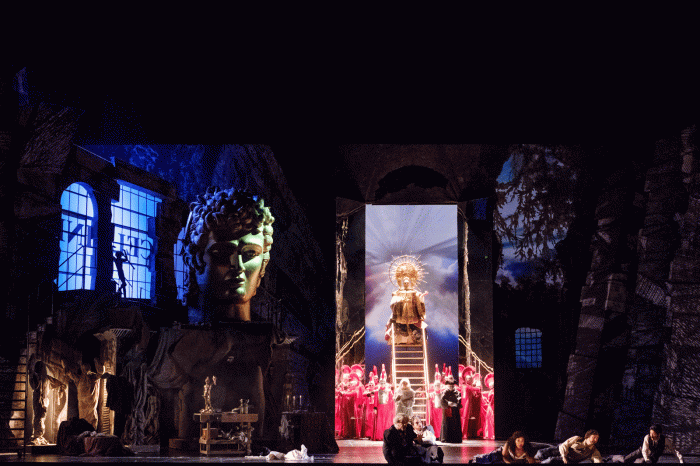
Ce personnage improbable qu'on dirait sorti de la plume d'Uderzo et Goscinny se situe quelque part entre brahmane fardé et gourou cocaïnomane. Ouvrant son cocon de paillettes, auréolé de rayons en strass sur fond vidéo figurant un ciel tourmenté, il descend le grand escalier qui lui servait de piédestal pour venir admirer de près les dernières créations de son protégé. Impossible de ne pas reconnaître au passage la référence au fameux Persée de la Loggia dei Lanzi. Le modèle réduit en plâtre figure au premier plan et surtout, l'immense tête dorée que Cellini menace de faire basculer dans le vide en provoquant au passage les cris du public. Le Pape est davantage intéressé par le postérieur géant et le reste de la statue monumentale que Terry Gilliam s'amuse à présenter en kit, avec une insistance toute particulière pour les généreux attributs du héros mythologique.

Tout ceci tient également de la farce et de l'humour de collégien, on dilue à grands traits un carnaval qui sert de couleur d'ensemble. À la barre de ce cortège-bacchanale, Philippe Jordan semble chercher ses marques, optant pour une direction sécurisante qui rame à contresens de la mise en scène. Les cordes sont parfaitement proportionnées, avec une égalité dans l'archet et le phrasé qui tient davantage d'une générale que d'une première. Les cuivres font des pointes là où il les faudrait tonitruants et les chœurs multiplient des décalages qui ne devraient pas tarder à disparaître au fil des représentations.

Les voix sont globalement très moyennes, à commencer par le Balducci très en retrait de Maurizio Muraro, avec une projection uniforme et des couleurs sans éclat. Autre déception (de taille), la jeune Pretty Yende qui n'arrive pas à dominer le contour syllabique de ses répliques avec une surface vocale étonnamment limitée et sans épaisseur. On monte d'un cran avec le Fieramosca sonore et puissant de Audun Iversen. En laissant de côté le strict souci de l'intelligibilité (souci d'une constance sans pareille dans cette production), il démontre des qualités de jeu et de caractère bouffe qui sauve le rôle. Dans le registre buffo-serioso Marco Spotti campe un pontifiant souverain, amoureux des arts et des formes. La voix tire un peu dans les premiers instants, mettant en péril l'intonation et la tenue, pour se révéler très progressivement dans une étendue somme toute assez précaire. Deux autres rescapés d'Amsterdam tirent brillamment leur aiguille du feu, à commencer par Michèle Losier en Ascanio et, bien entendu, le très attendu John Osborn dans le rôle-titre. La première se jette à corps perdu dans le (trop) court numéro du "Mais qu’ai-je donc ?", dont elle surmonte les difficultés par l'ampleur et la rondeur de son instrument. John Osborn domine son Cellini de la tête et des épaules, ajoutant au rôle une véhémence puisée ailleurs dans des rôles belcantistes ou français de grande ampleur (Guillaume Tell, La Favorite, La Juive, Le Prophète etc.). Le timbre est rayonnant, la vaillance de l'émission absolument convaincante, comme dans "La gloire était ma seule idole".


Tout à fait d'accord avec votre analyse (grosse déception pour Pretty Yende en particulier) avec une précision quand même sur la parfaite intelligibilité du français de John Osborn (nul besoin de sur titres pour le comprendre). J'entends d'ici le Wanderer nous vanter l'école américaine.…
Cette production a fait étape aussi à Rome en mars 2016
Corrigé dans l'article, merci de cette précision