Le décor, de Susanna Gschwender, apparaît à l’entrée en salle : un cube vaste, noir, vide, éclairé par des néons dissimulés dans le plafond.
Et rien d’autre.
Le même décor se rétrécira aux deuxième et troisième actes pour finir comme un corridor, le corridor de la mort.
Pas d’objets, aucun élément qui puisse accrocher l’œil. C’est d’un huis clos entre les personnages dont il s’agit. Car Bieito va s’intéresser à l’étrange trio entre Tosca, Mario et Scarpia, hors de tout contexte historique.
Peu à peu le spectateur découvre l’univers dans lequel tous évoluent, un univers d’aujourd’hui quelquefois un peu « glauque », des enfants en petit costume-uniforme, deux nains qui officient comme « servants », deux femmes de ménage dont l’un est danseur de Hip hop travesti servent d’assistants à Mario dans la construction de son œuvre. Un monde qui peut être lu comme marginal dans un univers glacial.
Dans cet espace les personnages traditionnels sont décalés : Le sacristain est un SDF qui porte avec lui des sacs de ferblanterie dont des images pieuses, aidé par Mario qui ne peint pas la Maddalena, mais construit une installation autour d’un modèle de sainte recouverte d’un voile (bientôt arraché laissant voir un corps enduit de peinture argentée, tel un ex-voto, bientôt enserré dans un réseau de bandes de papier adhésif blanc tendues de jardin à cour. Image saisissante de l’espace scénique devenu installation, qu’il est indispensable d’enjamber pour traverser la scène. Au milieu de cela une Tosca en jean et grosse laine, et un Scarpia en costume de politicien bien propre, qui portait en juin 2017 à la création une perruque blonde platinée…et à cette reprise des cheveux gris bien gominés (repentir ?). La référence à Donald Trump a été évidente pour tous au moment de la création, elle est moins évidente aujourd’hui, même si le Scarpia actuel reste dans ces traces.
Si Bieito est toujours intéressé par la question de l’exercice du pouvoir, de ses pressions, de ses excès, s’ajoute cette fois-ci une autre question qui quelquefois en dérive, la question de l’art, qui est aussi centrale dans l’air de référence de Tosca « Vissi d’arte ». À Scarpia s’opposent deux artistes, Mario et Tosca, qui vivent leur art dans la liberté indépendante des pouvoirs et de celui-là en particulier. Ils s’opposent par le style vestimentaire, leurs habits (costumes de Anja Rabes) un peu négligés, pull larges, tee shirts jeans face au costume parfaitement coupé de Scarpia, bleu nuit, chemise blanche, cravate rouge (l’allusion est claire…) et à ceux de ses deux sbires (Sciarrone et Spoletta) tout en noir, un noir clinique, qui accompagneront le drame jusqu’à la fin.
Tout commence par un panneau brandi par Angelotti : « Your silence will not protect you ». Invitation à la résistance. Le silence pesant et fort long qui initie le spectacle en est la traduction en salle. Ce silence est interrompu par la musique, c’est à dire l’art. L’Art comme résistance à l’oppression par sa seule existence.
Problématique centrale du premier acte où l’œuvre, c’est à dire l’installation de Mario barre l’espace, empêche les déplacements, oblige à chevaucher les bandes d’adhésif tendues, et en soi un obstacle. L’artiste, de plus est vu comme un marginal parmi les marginaux (le sacristain comme SDF, solidaire de l’artiste), pendant que la (bonne) société interviendra lors du chœur final avec au-devant ses enfants bien-sous-tous-rapports en petit uniforme d’un quelconque chœur ou d’un quelconque collège.
Les Va-nu-pieds contre les bien mis, les mal-pensant contre les bien-pensant : d’autant que l’installation de Mario est assez subversive, une sainte en voile qui dévoile sa nudité, une sainte enfermée au centre d’un réseau qui semble lui coller à la peau (au propre).

Alors importe peu la crise de jalousie de Tosca, importe peu aussi Angelotti, devenu un instrument de système, celui par qui tout va arriver : on sent bien que le système est là, oppressif, et qu’il est aux aguets de toute manière, avec ou sans Angelotti.
L’intervention de Scarpia, costume-cravate du politicien plus que du policier, est celle d’un hiérarque, voire d’un dictateur : l’Etat ici est structurellement policier, il n’est que de voir les regards inquisiteurs que portent les deux sbires, avec leur lubricité sous-jacente, il n’est que de voir l’allure de Scarpia, tiré à quatre épingles, représentant d’un Etat à l’apparence ordonnée mais en réalité pourri jusqu’à la moelle. Bieito ne cesse de dénoncer les pourritures du pouvoir (voir Die Gezeichneten encore récemment) mais cette fois-ci en s’attaquant à ce pilier du répertoire il en démonte les dessous. À la fin du premier acte, les sbires et Scarpia s’acharnent contre l’installation de Mario et la détruisent en arrachant l’enchevêtrement d’adhésif, laissant le modèle nu à terre. L’art vivant, l’art contemporain est insupportable à l’âme totalitaire. Le fascisme n’aime pas les « voleurs de feu ».
Qu’est-ce que Tosca ? C’est une histoire de fascisme ordinaire. Le film « E avanti a lui tremava tutta Roma » de Carmine Gallone avec Anna Magnani projetait l’histoire même de Tosca dans l’ambiance fasciste. Jonathan Miller jadis avait aussi transposé l’œuvre dans le même sens. Tosca s’y prête : le fascisme, c’est ici celui qui détruit l’amour, qui détruit les êtres, qui les oppose, et qui n’est sans cesse qu’apologie du mensonge et de la trahison. Mensonge l’apparente bien-pensance qui dissimule les turpitudes (déjà la présence des enfants annonce Gezeichneten), mensonge la religion alibi, pendant que Scarpia, qui est cet Etat délétère, profite de son pouvoir pour obtenir les femmes qu’il désire (au début du deuxième acte, il lutine une blonde platinée, et va demander à Tosca de s’habiller de la même manière, robe en lamé collante et perruque pour mieux exciter son désir fétichiste.
Il y a dans ce travail le premier plan, les échanges et les dialogues, et l’arrière-plan qu’on devine, la torture (de Mario) et le meurtre (d’Angelotti) . Bieito n’invente rien, il ne change absolument rien à l’histoire ni à son sens : il va seulement jusqu’au bout d’une logique en faisant de ce drame une tragédie sans entracte, 1h50 de déroulé continu comme si l’on suivait un fil logique et ininterrompu : tout l’espace scénique est espace tragique qui se rétrécit à mesure qu’on avance, devenant toujours plus étouffant et qui se concentre autour des enjeux de trois personnages, indépendamment de tout contexte historique ou géographique, soulignant ainsi que l’histoire de Tosca n’est justement pas historiée, et constitue un emblème des relations homme-femmes, du fascisme ordinaire, du pouvoir corrupteur dans un continuum dramatique qui augmente encore les tensions, un emblème d’aujourd’hui.
Rien de bien neuf sous le soleil, mais c’est ici affirmé avec une froideur clinique, qui élimine toute émotion humaine en ne gardant que l’animalité du désir, qu’il soit d’ailleurs de Scarpia ou des deux amants, et la violence.

Mario, marqué par la torture, à demi-nu, pantalon aux pieds, face à Tosca quand il apprend qu’elle a « donné » Angelotti lui arrache sa perruque et l’en frappe violemment, Tosca face à Scarpia joue en revanche la chair, et le tue alors qu’elle le chevauche…en l'abandonnant, le sexe couvert de sa perruque.
Le troisième acte est sans doute encore plus glaçant. La scène rest éduite à un corridor et au proscenium, Mario sanguinolent enserré dans du papier adhésif, celui-là même qui créait l’installation, comme prisonnier de son art, par là où il a péché, collé au mur et de l’autre côté du corridor Tosca, le tout sous les yeux des sbires préparant l’exécution.
Pas de peloton, mais une mort presque propre, et infâmante, l’artiste est clownifié, perruque rousse, maquillage blanc, et Tosca porte le cadavre, pendant que derrière accourt la foule brandissant le portrait de Scarpia, et donc crucifiant les deux artistes. Pas de suicide, pas de château Saint Ange, mais une crucifixion sans croix avec à la place de "INRI" le placard du début "Your silence will not protect you".
Le populisme est un totalitarisme, qui inverse les valeurs, la masse aime Scarpia. On a les saints qu’on peut…
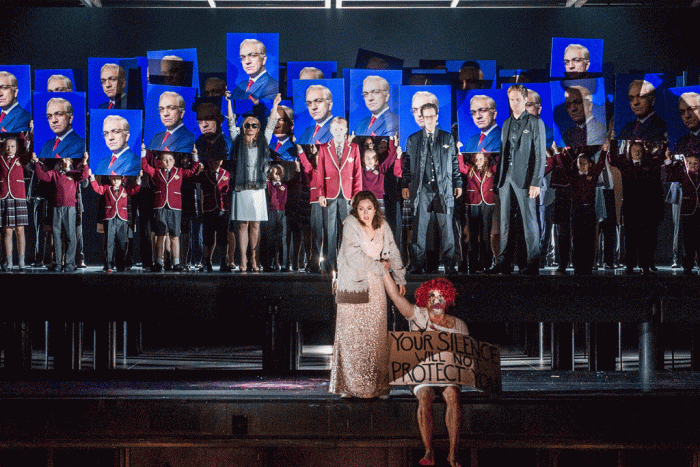
C’est bien effectivement le système qui a porté Trump au pouvoir qui est ici dénoncé, désir de rejet, d’exclusion, d’isolement de qui n’est pas dans la norme, sur fond de violence qui marginalise les artistes et les non conformes et favorise les bien-pensant. Bieito démonte un mécanisme en s’appuyant sur l’un des grands piliers du répertoire, qui s’y prête parfaitement, sans rien changer au sens, mais plongeant le spectateur dans l’introspection par ce regard sans concession sur le monde, au point que la question de l’amour est presque évacuée de l’histoire du couple, comme si les deux destins restaient séparés et solitaires. Terrible vision.
Musicalement, la direction de John Helmer Fiore épouse parfaitement le propos, il réussit à l’orchestre à fouiller les détails de la partition, à soigner le relief dramatique de l’œuvre, à rendre l’extrême tension qui règne sur le plateau. Fiore est un très bon chef d’opéra, de longue expérience (il a été GMD à Düsseldorf, il a aussi dirigé l’opéra d’Oslo), et il analyse les partitions avec pertinence (c’est notamment un bon wagnérien), sans jamais accentuer le volume, il sait appréhender avec fluidité l’ensemble, jamais démonstratif, mais veillant toujours à accompagner le drame, à en souligner la logique et la continuité : jouer Tosca sans entracte est d’ailleurs musicalement une expérience enrichissante qui permet de tisser encore plus de lien entre les différents moments, qui ne sont plus des moments d’ailleurs, mais des Stations d’une Passion. C’est une grande réussite musicale et l’orchestre d’ailleurs répond de manière impeccable aux sollicitations du chef, avec éclat et engagement.
Il n’en va pas aussi bien du côté du chant. L’ensemble des rôles secondaires m’est apparu plutôt satisfaisant, et il sagrestano de Pietro Simone fait entendre – c’est presque le seul, la prosodie de l’italien, les (vrais) accents dans une langue fluide, qui domine la conversation en musique exigée souvent par Puccini.
En effet, la gêne ne provient pas tant de la qualité vocale, mais du phrasé, et de l’expressivité du mot. Le Scarpia de Ole Jørgen Kristiansen ne pêche pas par insuffisance vocale : le timbre est sonore, la couleur de qualité, et devrait convenir aux rôles de barytons wagnériens (on entend un Alberich). Pour Scarpia, qui exige aussi l’expression, qui exige des accents particuliers, qui exige une fluidité linguistique, c’est beaucoup moins convaincant : les notes sont faites, les accents quand ils correspondent à une note sont exprimés, mais dès que l’on est dans la conversation ou le dialogue, cela devient inexpressif, avec l’impression que le texte est dit phonétiquement, sans qu’il y ait compréhension claire du mot. Il faudrait un chef de chant rompu à la langue et à la prosodie italiennes pour pouvoir reprendre l’ensemble du rôle. Quand il parle au sacristain de Pietro Simone, qui a l’italien en bouche et pour cause, c’est aveuglant. C’est vraiment le gros problème de ce chanteur car pour le reste, il a les qualités de voix et de présence voulues, mais il faut plus pour Puccini : il reste qu’il est bien inséré dans la mise en scène et que ce personnage glacial en apparence et dévoyé et vulgaire en réalité, existe en scène.

Daniel Johansson n’a pas tout à fait ce problème, la voix est vraiment magnifique, le timbre lumineux, les aigus sûrs : là on entend un Lohengrin, voire un Siegmund…moins un Mario parce qu’il a tendance à chanter trop ouvert, trop fort, et sans toujours donner dans la nuance : son « e lucevan le stelle » ne convainc pas, par manque de sensibilité, manque de couleur – toujours des sons un peu fixes -, et une incapacité à chanter piano alors que « recondita armonia » initial passe mieux . Ainsi de « Vittoria » du deuxième acte, où pour le deuxième « vittoria » l’accent et la note tenue sont sur le « o », il appuie bien trop sur le « i » – vitt-o-r‑i‑a , à la mode de Jussi Björling pour s’aider à tenir plus longtemps, comme bien d’autres ténors d’ailleurs (Corelli, Carreras, Domingo, Kaufmann) – pour lesquels c’est un peu moins marqué – mais outre à être fautif au niveau de l’accent, ça ruine un peu l’effet voulu quand la voix n’est pas légendaire : Gigli, Di Stefano, Pavarotti, Aragall, Alagna, en revanche, en ne donnant la note que sur le « o » puis sur le « a » final avaient un tout autre style et un tout autre effet… Il reste que le chanteur est le personnage (il a travaillé avec Bieito puisqu’il était dans la distribution de la Première et cela se voit) très engagé scéniquement et très crédible dans un rôle auquel Bieito demande beaucoup.
 Le « Vissi d’arte » de la jeune Nina Gravrok a été plutôt réussi, plutôt retenu, plutôt émouvant, avec une belle ligne. Mais pour l’ensemble du rôle, il manque un peu de corps à cette voix qui esquive l’aigu (ou le rate) de « Attavanti » au premier acte, et quelques autres. En général les suraigus ne passent pas et la voix manque d’homogénéité pour le rôle. Nina Gravrok est plutôt un soprano lyrique, on entendrait cette voix plus à l’aise dans Mimi. Tosca, c’est au-dessus de ses moyens réels et elle manque d’accents et d’expressivité quelquefois. Mais comme ses partenaires, elle est très crédible et très engagée dans le rôle et sert bien le dessein de la mise en scène.
Le « Vissi d’arte » de la jeune Nina Gravrok a été plutôt réussi, plutôt retenu, plutôt émouvant, avec une belle ligne. Mais pour l’ensemble du rôle, il manque un peu de corps à cette voix qui esquive l’aigu (ou le rate) de « Attavanti » au premier acte, et quelques autres. En général les suraigus ne passent pas et la voix manque d’homogénéité pour le rôle. Nina Gravrok est plutôt un soprano lyrique, on entendrait cette voix plus à l’aise dans Mimi. Tosca, c’est au-dessus de ses moyens réels et elle manque d’accents et d’expressivité quelquefois. Mais comme ses partenaires, elle est très crédible et très engagée dans le rôle et sert bien le dessein de la mise en scène.
Belle soirée d’opéra au total, surtout grâce à Bieito et Fiore, et malgré les réserves sur le chant.

