Avec le départ de Kazushi Ono s'ouvre à Lyon le règne du nouveau directeur musical Daniele Rustioni dont l'arrivée se fait sous de bons auspices avec la prestigieuse récompense d'"Opéra de l'année 2017" décernée par le magazine allemand Opernwelt. Paradoxalement, c'est par des revendications syndicales et une réponse de la direction que s'ouvre cette soirée, en préambule au War Requiem de Benjamin Britten. Dans l'attente d'un aboutissement des négociations concernant la rémunération des intermittents et supplémentaires, s'offre à nous l'image d'un plateau avec l'ensemble des chanteurs et les équipes techniques. Certes, le choix d'un Requiem en ouverture de saison peut interroger (après tout l'Orchestre de Paris avait opté il y a quelques semaines pour la musique de funérailles de la Reine Mary de Purcell…) ; on peut y lire le lien vivace qui touche à la fois à l'actualité et aux commémorations de la guerre de 1914–1918.
Impossible de se défaire d'une musique qui refuse l'agrément et le futile, comme pour mieux illustrer l'horreur d'une guerre qui est celle de toutes les guerres. Dans ces tonalités en noir et blanc, Yoshi Oida installe un vaste et lent cérémonial durant lequel l'action, à proprement parler, est mise à l'étiage tandis que le regard du spectateur se concentre sur les gestes et les mouvements millimétrés du chœur et des solistes. La présence d'un orchestre miniature sur scène évoque l'ambiance des casernes et des champs de bataille, complétée par un chœur (adultes et enfants) en costumes d'époque. Refusant l'option de styliser les protagonistes à la manière d'un Peter Sellars dans une Passion de Bach, le travail de Yoshi Oida se sert d'accessoires tels des bancs de bois, avec craie et tableau noir qui n'évitent pas le cliché pour délivrer un message voulu comme universel.
 Focalisée autour d'un cercueil dans lequel disparaissent les souvenirs et le corps du soldat Wilfred Owen, l'action se déploie comme un rituel dans lequel chaque geste à la pesanteur qui convient à une fatalité envahissante. La soprano Ekaterina Scherbachenko est une mater dolorosa errant dans un drame qui dit son nom à chaque instant. La mort est montrée dans une horreur anonyme, que ce soit par des poupées de chiffon ou par des tenues des soldats qui évoquent les cadavres en ne montrant que des formes alignées qui jonchent le sol. Dans un pareil contexte, ni la victoire, ni la défaite n'ont de sens et le travail de Oida s'applique à montrer qu'il serait indécent d'assigner une place ou une hiérarchie à des êtres qui sont avant tout des victimes.
Focalisée autour d'un cercueil dans lequel disparaissent les souvenirs et le corps du soldat Wilfred Owen, l'action se déploie comme un rituel dans lequel chaque geste à la pesanteur qui convient à une fatalité envahissante. La soprano Ekaterina Scherbachenko est une mater dolorosa errant dans un drame qui dit son nom à chaque instant. La mort est montrée dans une horreur anonyme, que ce soit par des poupées de chiffon ou par des tenues des soldats qui évoquent les cadavres en ne montrant que des formes alignées qui jonchent le sol. Dans un pareil contexte, ni la victoire, ni la défaite n'ont de sens et le travail de Oida s'applique à montrer qu'il serait indécent d'assigner une place ou une hiérarchie à des êtres qui sont avant tout des victimes.
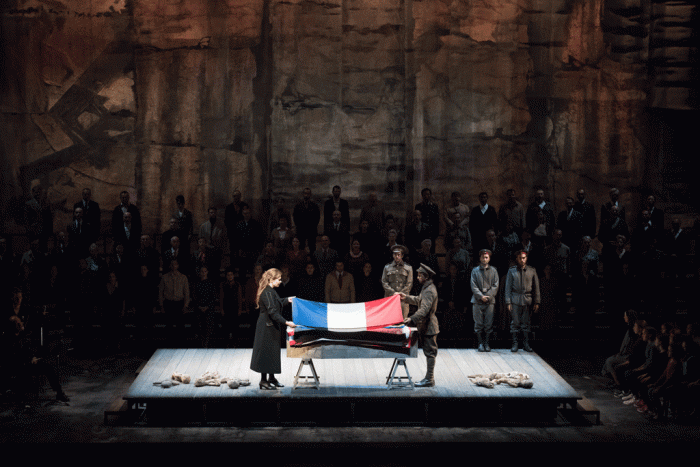 La cérémonie des drapeaux que l'on plie avec une rigueur obstinée, donne une force inouïe à un symbole d'ordinaire galvaudé et nationaliste. Repliés l'un sur l'autre au-dessus du cercueil, ils forment un sédiment unique qui illustre parfaitement l'inutilité de la mort et de la guerre. Certes, le drapeau allemand jure par l'anachronisme de ses couleurs et le portrait du français Louis Barthas se mêle avec incongruité à ceux des disparus de la Grande Guerre mais l'essentiel est ailleurs, dans ces artefacts ou ces uniformes fondus dans une même couleur et qui appellent à une fraternisation générale.
La cérémonie des drapeaux que l'on plie avec une rigueur obstinée, donne une force inouïe à un symbole d'ordinaire galvaudé et nationaliste. Repliés l'un sur l'autre au-dessus du cercueil, ils forment un sédiment unique qui illustre parfaitement l'inutilité de la mort et de la guerre. Certes, le drapeau allemand jure par l'anachronisme de ses couleurs et le portrait du français Louis Barthas se mêle avec incongruité à ceux des disparus de la Grande Guerre mais l'essentiel est ailleurs, dans ces artefacts ou ces uniformes fondus dans une même couleur et qui appellent à une fraternisation générale.
Cette fraternisation est rappelée dans la scène où soldat allemand et anglais tombent dans les bras l'un de l'autre. Elle se double de l'épisode du sacrifice d’Abraham montré comme spectacle de marionnettes forçant le trait d'une guerre perçue à la fois comme gaminerie innocente et jeu pour adultes – un jeu où même la religion n'est pas à prendre au sérieux. Le corps des enfants que l'on enveloppe dans les drapeaux ou la vidéo du mur qui s'effondre brique après brique, sont autant de signes évidents d'un message qui ne cesse d'être réitéré, au risque de perdre en intensité.
Le plateau relève de belle manière certaines scènes qui manquent de basculer dans la componction lénifiante. C'est l'estonien Lauri Vasar qui fait les frais d'une écriture vocale exigeante qui le met en porte-à-faux dans les moments de tension (Be slowly lifted up dans le Dies Irae ou After the blast of lightning dans le Sanctus). Le ténor anglais Paul Groves est remarquable d'aisance et de projection dans un rôle qui semble écrit à la dimension de sa voix. Son dialogue avec les masses chorales dans l'Agnus Dei (One ever hangs) révèle une bouleversante palette expressive. Retenue et comme en équilibre sur le fil de l'émotion, Ekaterina Scherbachenko chante avec la rigueur et l'exigence d'une technique sous surveillance. C'est peu de dire que la direction de Daniele Rustioni est aux antipodes d'une telle prudence. Son geste vigoureux brosse à grands traits cette liturgie laïque, à la manière d'un oratorio où l'absence de Dieu devient douleur et passion. Cette vision fait la part belle au chœur et à la Maîtrise qui se taille au passage un beau succès bien mérité, parfois poussé dans ses retranchements mais toujours d'une autorité à couper le souffle.


