Le second des trois programmes du cycle Schubert était consacré aux trois symphonies médianes. Le troisième ne comportera que les deux dernières, Barenboim, qui adopte ici le même principe que pour son intégrale des sonates, ne jouant que les partitions achevées par Schubert (à part l'inachevée, cela va mieux en le disant). Chacun des trois programmes sera rejoué fin juin-début juillet. Donner ensemble la triade centrale est sans doute plus piégeux que de le faire avec l’initiale, parce que stylistiquement, formellement, et enfin dans l’accent émotionnel, les 4e, 5e et 6e sont aussi dissemblables que les trois premières sont homogènes. La 5e, qui ouvrait logiquement le concert compte-tenu de son effectif d’harmonie réduit (pas de clarinettes ni de timbales, une seule flûte), ajoute à cette difficulté sa propre hétérogénéité interne de styles, qui, à l’instar de bien des mouvements des quatuors de jeunesse de Schubert, est assez facile à circonscrire : le premier mouvement est du Schubert de maturité bien reconnaissable, quand le second est un hommage appuyé à Mozart, le menuet également quoi que son trio soit de facture plus personnelle (« un laendler, mais citadin ; on n’y sent pas la terre. » avait un jour déclaré Harnoncourt), et le finale un quasi-pastiche de la manière du jeune Beethoven. Ce caractère de collage est cependant rarement voisinage. La Staatskapelle frappe d’emblée par un niveau de fini instrumental des plus élevés, et supérieur à ce qu’elle a donné l’habitude de voir à Paris ces dernières années, en-dehors de quelques parties de concert (notamment du cycle Beethoven-Schoenberg de 2009). La salle (on y reviendra plus loin), c’est une évidence, y oblige, car tout s’entend, non seulement à l’échelle des pupitres, mais quasiment des individus. La responsabilité des cordes est donc écrasante, et bien peu de formations assumeraient avec autant de classe, dans ces conditions acoustiques, la tâche assignée par Barenboim. Laquelle ne manque pas d’ambition.
 Car ce qui frappe dès cette 5e, certes indéniablement chambriste, c’est l’absence de concession faite par le chef quant à ses credos esthétiques. Comme dans ses Mozart, Beethoven ou Schumann, le refus de raccourcir le phrasé, l’attention à la menée au bout des crescendos expressifs, l’exécution littérale des valeurs de notes sont la règle. Mais ici encore, il n’en résulte pas une interprétation de pur hédonisme mélodique, ni le pêché de lourdeur romantique que l’on pouvait appréhender. Barenboim se garde donc, dans le premier mouvement où une telle tentation existe, de passer les plats des violons vers les bois et retour, d’une voix principale à une autre, et recherche comme toujours le conflit, la tension entre deux phrases désireuses d’aller à leur terme. On peut peiner à se représenter ce que serait une 5e de Schubert furtwänglerienne (la tradition germanique s’est néanmoins approprié la partition, et comment, avec Erich Kleiber et Eugen Jochum). Barenboim y aide assez, substituant à la circulation confortable des traits une fontaine jouisseuse de jaillissements lyriques superposés, ce qui rend justice à l’esprit, notamment, du développement du I, et de l'épisode mineur du IV, d'une sauvagerie disciplinée, sans l'espèce d'électrisation étriquée qu'il peut être de bon ton, aujourd'hui, d'y ajouter. Ce n’est pas la grâce mais plutôt l’ampleur lyrique mozartienne du II qui est flattée, sans traîner mais avec une sonorité dense et sombre valorisée par l’immédiateté de la salle. L'équilibre traversant l'ensemble de ce cycle est clairement énoncé, défendu et illustré : de la grandeur dans l'intimité, de la hauteur malgré la proximité. La flûte de Claudia Stein et le hautbois de Cristina Gomez Godoy font des promesses qui seront tenues tout au cours de la soirée.
Car ce qui frappe dès cette 5e, certes indéniablement chambriste, c’est l’absence de concession faite par le chef quant à ses credos esthétiques. Comme dans ses Mozart, Beethoven ou Schumann, le refus de raccourcir le phrasé, l’attention à la menée au bout des crescendos expressifs, l’exécution littérale des valeurs de notes sont la règle. Mais ici encore, il n’en résulte pas une interprétation de pur hédonisme mélodique, ni le pêché de lourdeur romantique que l’on pouvait appréhender. Barenboim se garde donc, dans le premier mouvement où une telle tentation existe, de passer les plats des violons vers les bois et retour, d’une voix principale à une autre, et recherche comme toujours le conflit, la tension entre deux phrases désireuses d’aller à leur terme. On peut peiner à se représenter ce que serait une 5e de Schubert furtwänglerienne (la tradition germanique s’est néanmoins approprié la partition, et comment, avec Erich Kleiber et Eugen Jochum). Barenboim y aide assez, substituant à la circulation confortable des traits une fontaine jouisseuse de jaillissements lyriques superposés, ce qui rend justice à l’esprit, notamment, du développement du I, et de l'épisode mineur du IV, d'une sauvagerie disciplinée, sans l'espèce d'électrisation étriquée qu'il peut être de bon ton, aujourd'hui, d'y ajouter. Ce n’est pas la grâce mais plutôt l’ampleur lyrique mozartienne du II qui est flattée, sans traîner mais avec une sonorité dense et sombre valorisée par l’immédiateté de la salle. L'équilibre traversant l'ensemble de ce cycle est clairement énoncé, défendu et illustré : de la grandeur dans l'intimité, de la hauteur malgré la proximité. La flûte de Claudia Stein et le hautbois de Cristina Gomez Godoy font des promesses qui seront tenues tout au cours de la soirée.

L’absence de répétition des expositions des mouvements extrêmes est plus préjudiciable à l’équilibre dramatique de la 4e. Pour autant, on ne saurait reprocher à Barenboim de ne prendre au sérieux le statut de Tragische de cette œuvre, qu’il aborde de manière roborative mais sans pesanteur. Les tempos sont médians relativement à la norme, dans chaque mouvement. Le sens parfaitement classique de la forme fait merveille dans chaque préparation de réexposition (la modulation solaire des flûtes avant celle du finale !). Par ses chromatismes aux placements étranges, le menuet est le plus brucknérien de tous ceux de Schubert, et Barenboim, qui nage dans cette musique ces années-ci, le flatte presque à l'excès (le vivace de cet allegro étant un peu oublié). Un élément étonnant, et pour tout dire assez inexplicable, est l’incohérence de phrasé (au moins, est-elle identique à elle-même les deux fois) dans les épisodes d’agitation en fa mineur de l’andante. Les bois jouent les quatre notes dans un très inhabituel et très soigneux legato, ce à quoi les violons puis les basses répondent à la manière usuelle, détachée, avec un coup d’archet par note. L’effet produit est pour le moins bizarre et très peu académique, toutes les occurrences de ce motif étant du reste écrites à l’identique, avec un staccato qui peut certes s’apprécier diversement mais exclut de lier toute la phrase. Pour autant, il n’est pas ridicule ni inintéressant, et interroge, en créant de l’inconfort, quant à la nature du motif.
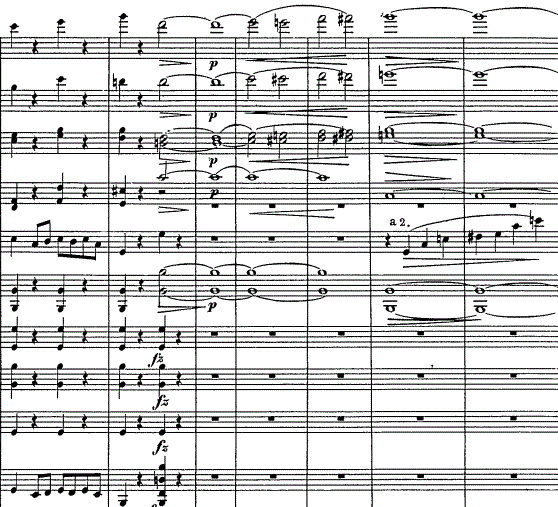 Les mouvements extrêmes sont d’une très belle lisibilité en dépit de l’esthétique de confrontation polyphonique permanente. Les conditions acoustiques et le placement (quatrième rang centré) permettent de goûter l’intensité toute chambriste des relations – cette réactivité au demi-regard ! – entre premiers et seconds violons, placés en vis-à-vis. La précision rythmique et de phrasé des figures d’accompagnements (comme l’accent si décisif sur les quatrièmes temps rompant le trémolo dans le thème du finale) est fascinante, et le travail du chef d’attaque Knut Zimermmann exceptionnel, ici et dans quantité d'endroits. Car cette virtuosité classique n’a pas l’arrière-goût technicien et artificiel de tant de spécialistes du dépoussiérage ou du dégraissage (qu’ils disent !) de ces répertoires. Rien n’est suraccentué, rudoyé pour feindre d’être vivant, et d’un bout à l’autre cette Tragique conserve sa dignité hautaine par-delà une démonstration instrumentale et une animation de chaque instant. Muti, on en parlera bientôt, ira certes plus loin dans le sens discret de la grandeur, dans la réserve auguste.
Les mouvements extrêmes sont d’une très belle lisibilité en dépit de l’esthétique de confrontation polyphonique permanente. Les conditions acoustiques et le placement (quatrième rang centré) permettent de goûter l’intensité toute chambriste des relations – cette réactivité au demi-regard ! – entre premiers et seconds violons, placés en vis-à-vis. La précision rythmique et de phrasé des figures d’accompagnements (comme l’accent si décisif sur les quatrièmes temps rompant le trémolo dans le thème du finale) est fascinante, et le travail du chef d’attaque Knut Zimermmann exceptionnel, ici et dans quantité d'endroits. Car cette virtuosité classique n’a pas l’arrière-goût technicien et artificiel de tant de spécialistes du dépoussiérage ou du dégraissage (qu’ils disent !) de ces répertoires. Rien n’est suraccentué, rudoyé pour feindre d’être vivant, et d’un bout à l’autre cette Tragique conserve sa dignité hautaine par-delà une démonstration instrumentale et une animation de chaque instant. Muti, on en parlera bientôt, ira certes plus loin dans le sens discret de la grandeur, dans la réserve auguste.
Finir quelque concert que ce soit avec la 6e n’est certainement pas à la portée de grand monde. La partition reste la plus énigmatique, du moins résistante à l’appropriation, du corpus orchestral du compositeur. La raison principale en est le déséquilibre, de longueur et de richesse de matériau, en faveur du finale. Une autre étroitement corrélée est que ce problème est aggravé par le fait que ce rondo est presque toujours joué à un tempo déraisonnablement rapide, qui d’une part altère beaucoup la nature du thème principal, et le tire vers la trivialité, et d’autre part ne traite la difficulté du déséquilibre que sur un mode annulatoire. Il est d’ailleurs intéressant que les seuls (ou quasiment) chefs (intégralistes du reste) à avoir trouvé le ton et la battue juste (outre Böhm) dans cette page furent le souvent décrié Karajan, et le radical Harnoncourt : deux icônes que tout opposait, mais deux aristocrates viennois. Les voilà rejoints par Barenboim, qui confirme ici de façon approfondie l’intuition du tempo giusto qu’il avait eue lors de sa propre intégrale avec les Berliner. Cependant, là où Karajan valorisait à outrance le trait prussien des quatre thèmes (du premier et du quatrième surtout), Barenboim anime et se fait plus joueur à partir du second, et cède un peu à son penchant cabotin dans le quatrième (le mime de l’envolée des flûtes et clarinettes), ce qui revient essentiellement à laisser s’ébrouer librement l’orchestre, son impeccable petite harmonie au premier chef. Pour autant, l’affaire reste sérieuse jusqu’au bout, et l’on devine que les protagonistes n’ont pas fini d’approfondir cette symphonie en vue de l’exécution du mois suivant, certains passages des deux derniers mouvements étant commentés par Barenboim, à destination de certains pupitres, comme en répétition. Mais qui a déjà assisté à une belle répétition, filmée ou a fortiori en salle, sait que c’est aussi là que vit, parfois plus authentiquement, la musique. Les solistes de l’orchestre, déjà épatants jusqu’ici, brillent de mille feux dans le thème italien du I, et surtout dans les épisodes secondaires du II, où leur babille atteint un chic et une profondeur delà toute intelligence. Dans cette superbe conclusion, loin d’être acquise au succès par avance, on pouvait aussi deviner tout ce que la pratique régulière de l’intégrale des sonates (enregistrée par Barenboim il y a deux ans, donnée notamment à la Philharmonie de Paris et à nouveau au printemps à la Boulez Saal) a apporté à sa direction schubertienne, sans doute plus attentive au détail de l’accent et à la justesse du caractère qu’il y a vingt ou trente ans, quand il ne pratiquait pas D.537, 568, 575, 850 ou 894, et leurs rondos versatiles et de structures compliquées (qui étaient souvent les mouvements les plus remarquables sous ses doigts).

Il est impossible de ne pas évoquer les conditions d’écoute créées par ce nouveau haut-lieu de la vie musicale européenne. Il y a bien sûr l’acoustique proprement dite, mais qui, plus qu’ailleurs, n’est qu’une partie, cohérente avec le tout, d’un projet plus général. On a pu deviner que la salle avait partiellement été pensée pour rendre justice aux explosions de timbres et au sostenuto-style de la musique d’ensemble du second XXe siècle et du temps présent, et singulièrement aux alliages percussifs de Sur Incises (même si la grandeur théâtrale de l’œuvre semble encore mieux réalisée dans la douceur et la vastitude de la Philharmonie de Paris). Ce qui frappe ici, par rapport à d’autres salles où la scène est placée au centre et où l’analytique est visé, est l’absence de sécheresse. L’ellipse berlinoise réussit là où celle de feu la Cité de la musique a échoué : la précision n’y est pas du tout obtenue au détriment de la chaleur et du grain. L’astucieux chemin de ronde surplombant le premier niveau, sous la galerie supérieure, est paré de panneaux acoustiques transparents qui, tout en préservant la grande économie visuelle du lieu, permet la circulation rapide et continue du son. Dans ce cycle Schubert, (comme pour celui des sonates avec le piano) l’orchestre pivote à 180° à l’entracte. Ainsi, l’on se retrouve face à Barenboim pour la 6e Symphonie ; et pourtant, même si les timbales parasitent immanquablement, mais très occasionnellement l’écoute, les dynamiques, le grain et la vie intérieure des pupitres de cordes nous parvient quasiment comme en première partie, par la rotation du son. Cela demande à être vérifié, mais il est aussi vraisemblable qu’au balcon, la différence soit encore plus réduite, et l’impact dynamique supérieur.
 Il convient d’étendre ces observations aux conditions musicales au sens large, qui ne se réduisent pas à l’acoustique, mais à la conception d’ensemble du lieu, jusqu’à son rapport à la rue, sur laquelle la salle ouvre presque directement. Le vaste bâtiment de la Französische Strasse, sis à quelques pas de la Staatsoper à laquelle elle servit de halle à décors, accueille ses visiteurs par un panneau où Boulez nous met en garde avec l’œil à jamais goguenard : « Man sollte das Konzert grundsätzlich als Kommunikationsmittel betrachten, als lebendigen Kontakt zwischen aktiven Personen, seien sie Hörende oder Schaffende. » Le credo de l’expérience participative, de l’implication du public, de l’interaction entre les musiciens et lui, a un goût de réchauffé démagogique, dira-t-on non sans raisons. Quant à celui de l’écoute et de l’échange, de la circulation démocratique des idées interprétatives et des cultures entre musiciens, comme parabole sociale, s’il est beaucoup incarné dans l’ère Abbado – berlinoise et lucernoise – et continue de l’être d’une autre façon, évidemment plus politique, par Barenboim, il est plus difficile d’en faire un viatique posthume boulézien – singulièrement s’agissant de la direction d’orchestre ou de la conception du canon culturel. Mais l’épitaphe peut se comprendre indépendamment de ces deux lectures, et au fond d’une façon plus simple, quoi qu’adornienne. Un concert doit demeurer un événement spécial, spécialement à l’ère, pourrait-on dire, de l’immédiateté technique. Il ne peut pas être écouté comme un disque, et les musiciens n’y doivent pas jouer comme pour des micros. L’excellence technique, l’exigence intellectuelle, l’impératif de curiosité et d’audace, tout cela est requis mais ne suffit pas. La relation musicale commune à l’interprète et à l’auditeur passe par une intensification physique qui force à élever le niveau de toutes les demandes que l’on vient d’énumérer. Jouer plus précisément, écouter avec davantage de concentration ; diriger en soignant davantage l’intelligibilité, sans le céder au détail ; observer modestement certes, à sa place qui n'est pas celle d'acteur, mais justement pas comme au spectacle, confortablement parqué avec ses semblables, mais comme un convive à une réunion.
Il convient d’étendre ces observations aux conditions musicales au sens large, qui ne se réduisent pas à l’acoustique, mais à la conception d’ensemble du lieu, jusqu’à son rapport à la rue, sur laquelle la salle ouvre presque directement. Le vaste bâtiment de la Französische Strasse, sis à quelques pas de la Staatsoper à laquelle elle servit de halle à décors, accueille ses visiteurs par un panneau où Boulez nous met en garde avec l’œil à jamais goguenard : « Man sollte das Konzert grundsätzlich als Kommunikationsmittel betrachten, als lebendigen Kontakt zwischen aktiven Personen, seien sie Hörende oder Schaffende. » Le credo de l’expérience participative, de l’implication du public, de l’interaction entre les musiciens et lui, a un goût de réchauffé démagogique, dira-t-on non sans raisons. Quant à celui de l’écoute et de l’échange, de la circulation démocratique des idées interprétatives et des cultures entre musiciens, comme parabole sociale, s’il est beaucoup incarné dans l’ère Abbado – berlinoise et lucernoise – et continue de l’être d’une autre façon, évidemment plus politique, par Barenboim, il est plus difficile d’en faire un viatique posthume boulézien – singulièrement s’agissant de la direction d’orchestre ou de la conception du canon culturel. Mais l’épitaphe peut se comprendre indépendamment de ces deux lectures, et au fond d’une façon plus simple, quoi qu’adornienne. Un concert doit demeurer un événement spécial, spécialement à l’ère, pourrait-on dire, de l’immédiateté technique. Il ne peut pas être écouté comme un disque, et les musiciens n’y doivent pas jouer comme pour des micros. L’excellence technique, l’exigence intellectuelle, l’impératif de curiosité et d’audace, tout cela est requis mais ne suffit pas. La relation musicale commune à l’interprète et à l’auditeur passe par une intensification physique qui force à élever le niveau de toutes les demandes que l’on vient d’énumérer. Jouer plus précisément, écouter avec davantage de concentration ; diriger en soignant davantage l’intelligibilité, sans le céder au détail ; observer modestement certes, à sa place qui n'est pas celle d'acteur, mais justement pas comme au spectacle, confortablement parqué avec ses semblables, mais comme un convive à une réunion.
Créer une institution, à plus forte raison esthétique, c’est exprimer, de la plus forte façon, une vision du monde – comme on a pu dire sous Karajan que le jeu du Philharmonique du Berlin exprimait une vision du monde. Instituer une façon de vivre dans la musique est bien ce qu’ont eu en vue dans des configurations et contextes différents, la Gesellschaft der Musikfreunde à Vienne il y a deux siècles, le Domaine Musical et ses successeurs à Paris, Bayreuth et le Neues Bayreuth ou la nouvelle Philharmonie de Berlin au milieu du siècle dernier, et ainsi pour notre siècle cet ensemble. Il est de son temps aussi en ce qu'il propose un continuum institutionnel : académie-ensemble-salle, qui ne sera pas de trop pour prolonger encore un peu une vie musicale de plus en plus atomisée en même temps que conformiste, à l'image de la société qui l'héberge.


Article bien intéressant, mais qui s'adresse à un public vraiment averti. Ce que j'en ai pu comprendre m'a éclairé, mais ne représente qu' une part réduite du propos.