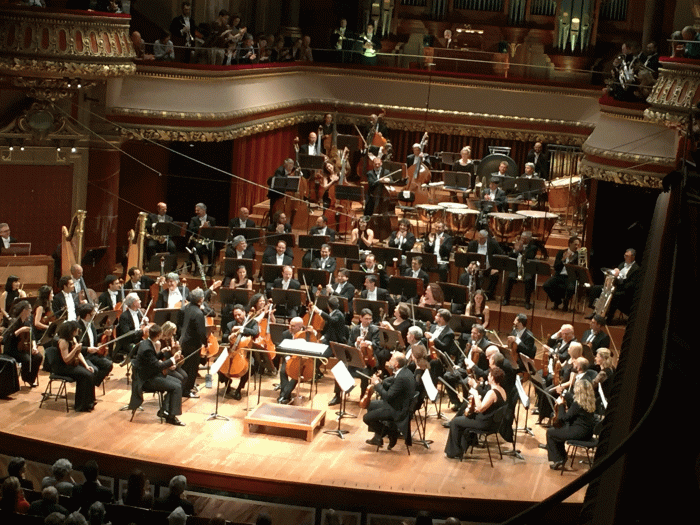
Série d'hommages croisés dans ce concert au programme étonnant : un hommage à Rome par un compositeur suisse, Richard Dubugnon, originaire de Lausanne, joué par le meilleur orchestre symphonique italien (romain) de passage à Genève. Et puis, Les Fontaines et les Pins de Rome de Respighi, autre hommage à Rome, puis enfin en bis l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini (exactement la seconde partie) un bis obligatoire dans la patrie du héros.
Au milieu, ce concerto n°1 de Tchaïkovski fait office de concession au public et aux grands standards orchestraux d'autant que Yuja Wang, star du clavier est au piano. On aurait programmé au lieu du concerto le Capriccio italien de Tchaïkovski, la cohérence programmatique eût été parfaite…
Sir Antonio Pappano avant de prendre la baguette prend le micro pour expliquer l'origine et la construction du Caprice romain n°3 de Richard Dubugnon. L’entreprise est sympathique, d’autant que le chef s’exprime en français, et explique les origines de l’œuvre en présentant quelques interventions instrumentales en exemple, à la manière de Bernstein dans ses fameuses leçons et en expliquant quelques éléments de l’œuvre, qui renvoie à la découverte de Rome par l’enfant de 8 ans qu’était le compositeur ; rien de tel pour créer une vraie disponibilité du public pour la pièce contemporaine, dont on sait qu’elle est souvent subie plus qu’attendue.
Le Caprice romain n°3 op.72 a été créé à Rome la semaine précédente, commande de l’orchestre au compositeur suisse ; ceux qui craignent la musique contemporaine se rassurent car la pièce est de facture très classique, utilisant la plus large palette instrumentale (y compris des cloches à quatre mains), ce qui permet à l’orchestre de faire entendre la qualité des instruments solistes, la dynamique, les passages très contrastés de pianissimo à fortissimo voire une certaine tension. Dubugnon rappelle le 3ème acte de Tosca en évoquant ces cloches matinales qui traversent le silence d’une ville qui se réveille, il joue aussi sur SPQR (Senatus populusque romanus) que l’on voit un peu partout dans la ville (et notamment les bouches d’égout), les 12 minutes passent vite, avec une musique qui par ses jeux instrumentaux évoque surtout une musique des années 20 ou 30 (hommage à Respighi ?) où on entend des échos de Bartok ou de Stravinsky, voire de Roussel, un « Caprice » non dénué d’ironie et qui demande à l’orchestre de véritables acrobaties et le place immédiatement à un très grand niveau. L’œuvre est accueillie chaleureusement par le public qui gratifie orchestre chef et compositeur (né en 1968) d’une véritable ovation méritée. Bon vent.
Plus « classique », le choix du Concerto n°1 de Tchaïkovski pour piano interprété par la pianiste désormais starisée Yuja Wang : c’est pourtant à mon avis une erreur programmatique. Sur sa lancée, l’orchestre eût pu interpréter d’autres œuvres inspirées par Rome, que ce soit le Carnaval Romain de Berlioz, le Capriccio Italien évoqué plus haut, ou même, pourquoi pas, l’ouverture du Rienzi de Wagner.
Ce concerto ne restera pas dans les mémoires : à part l’accompagnement clair, limpide et transparent de l’orchestre, avec une énergie peu commune, le piano n’inspire pas, il n’y a pas d’âme dans ce travail virtuose et acrobatique où la technique démonstrative (qui commence même par des accords arpégés au départ) ne démontre qu’elle même parce qu’elle n’est au service de rien d‘autre qu’elle-même. Certes, aussi bien dans le premier que dans le dernier mouvement, l’incroyable vélocité et l’incroyable précision de la jeune pianiste sont exposées telles quelles, mais à aucun moment on entend un Tchaïkovski tant soit peu intérieur et disons-le, on s’ennuie. Le premier bis (un extrait de l’Orfeo de Gluck transcrit pour le piano) le confirme tant la pièce qui pourrait inspirer un peu d’émotion reste plate. Le second, une variation brillante et jazzy sur la marche turque confirme ce qu’on savait déjà, à savoir que Yuja Wang est étourdissante de technique, et permet de finir en sourire et en triomphe. Un jour, plus tard, Madame Wang peut-être ressentira et fera ressentir : pour l’instant elle montre, elle démontre, elle surmonte, mais n’atteint jamais l’âme ni le cœur.
Bien plus éblouissante la seconde partie, composée des deux poèmes Le Fontane di Roma et I pini di Roma créés par cet orchestre respectivement en 1917 (par Antonio Guarneri) et 1924 (par Bernardino Molinari). Nous sommes évidemment au cœur du répertoire historique de cet orchestre qui reste, et qui l’a encore prouvé ce soir, non seulement la meilleure phalange de la péninsule, mais aussi l’un des grands orchestres européens.
Il y a dans cette musique quelquefois injustement ignorée ou méprisée (on n’aime pas toujours les musiques à programme) une véritable symphonie de couleurs, qui jongle dans Fontane di Roma avec les différents moments décrits, aube, matin, midi, crépuscule, qui sont différents ambiances (du bucolique à l’urbain), de réel au mythologique : un travail sur la métaphore qui joue sur les thèmes de chaque fontaine, mais aussi sur les eaux qui jouent (on pense quelquefois à Debussy, à Strauss, et bien sûr au suprême coloriste qu’est Rimsky-Korsakov, auprès duquel Respighi a étudié.
Quelques années après, Respighi rend hommage non plus aux constructions si emblématiques du paysage Urbain que sont les fontaines romaines, mais à la nature domptée ou pas à laquelle renvoient les pins de Rome, en tout cas à des lieux et des ambiances, Villa Borghese, le grand parc de Rome, occasion d’évoquer les jeux des enfants, les Catacombes, plus sombres, une musique obscure et retenue, après la vie des enfants les évocations des morts, le Janicule, venteux, « tremolante », et enfin la Via Appia, qui bruisse d’une armée romaine en triomphe et finit en majesté. Cette musique qui doit tant aussi à l’impressionnisme de Debussy et Ravel rend à l’oreille une multiplicité de couleurs et d’ambiances, on l’a dit, mais pour l’orchestre une multiplicité de palettes sonores, tantôt subtiles, tantôt spectaculaires, tantôt retenues, tantôt explosives. Les violons (magnifique violon solo) sont incroyablement agiles, les bois somptueux, flûte et notamment clarinette emmenée par le magnifique Alessandro Carbonare, l’un des plus grands clarinettistes au monde, les cuivres , vraiment magnifiques d’éclats mais aussi quelquefois de subtilités (le corniste Alessio Allegrini est lui aussi l’un des cornistes de référence dans le monde musical). Mais on est frappé de la dynamique, de l’éclat, de l’émotion aussi diffusée par cette musique et de la capacité d’Antonio Pappano à faire ressentir, à évoquer, à dessiner des ambiances multiples et différentes. Rien d’ennuyeux, rien de monotone, mais au contraire une musique moirée d’ombres et de lumières, d’aube et de crépuscule, une musique aussi complexe, et magnifiquement construite : quel magnifique crescendo final, si utilisé dans le cinéma directement ou indirectement, qui élargit l’horizon, qui illumine véritablement la soirée en une sorte de vision cinépanoramique de la romanité en une harmonie qui fait image. Fulgurant.
Deux bis très différents, la valse triste de Sibelius, interprétée avec fluidité et subtilité pour rentrer un peu soi, puis un hommage conjoint à la Suisse et l’Italie, la seconde partie de l’ouverture de Guillaume Tell de Rossini prodigieuse de vitalité et d’énergie. Accueil triomphal du public, mérité, pour un chef de référence dans bien des répertoires, et pour un orchestre qui reste l’une des grandes phalanges européennes complètement dévouée à son chef depuis 2005 et qui a montré ce soir une incroyable maîtrise. Somptueux.

